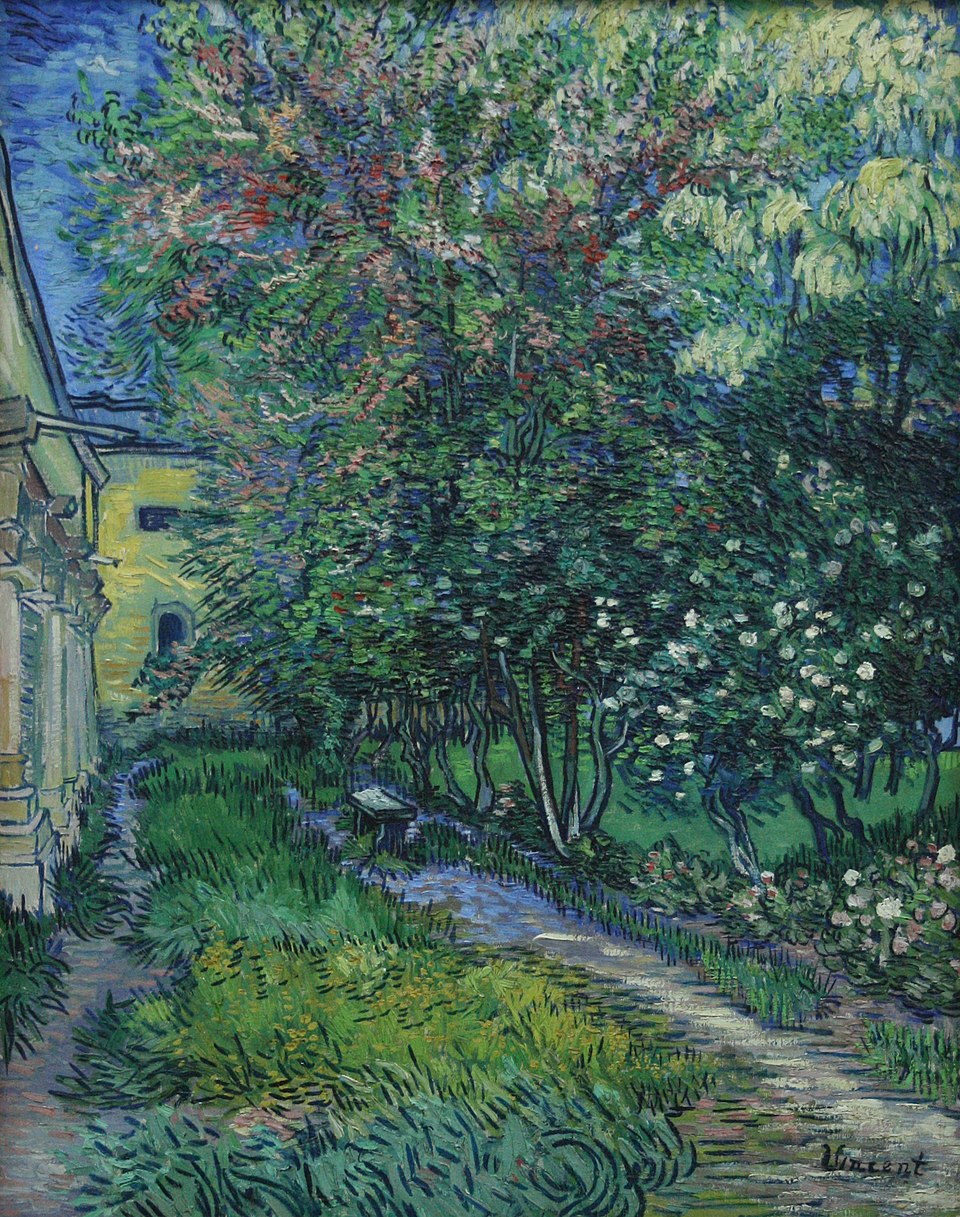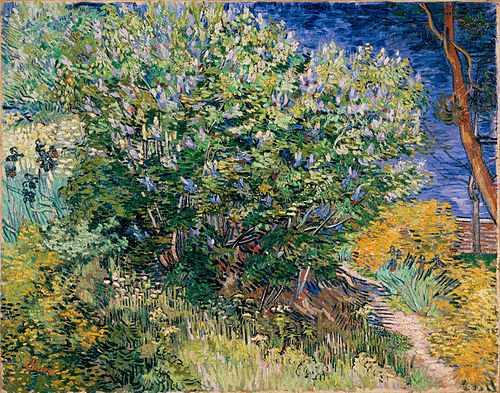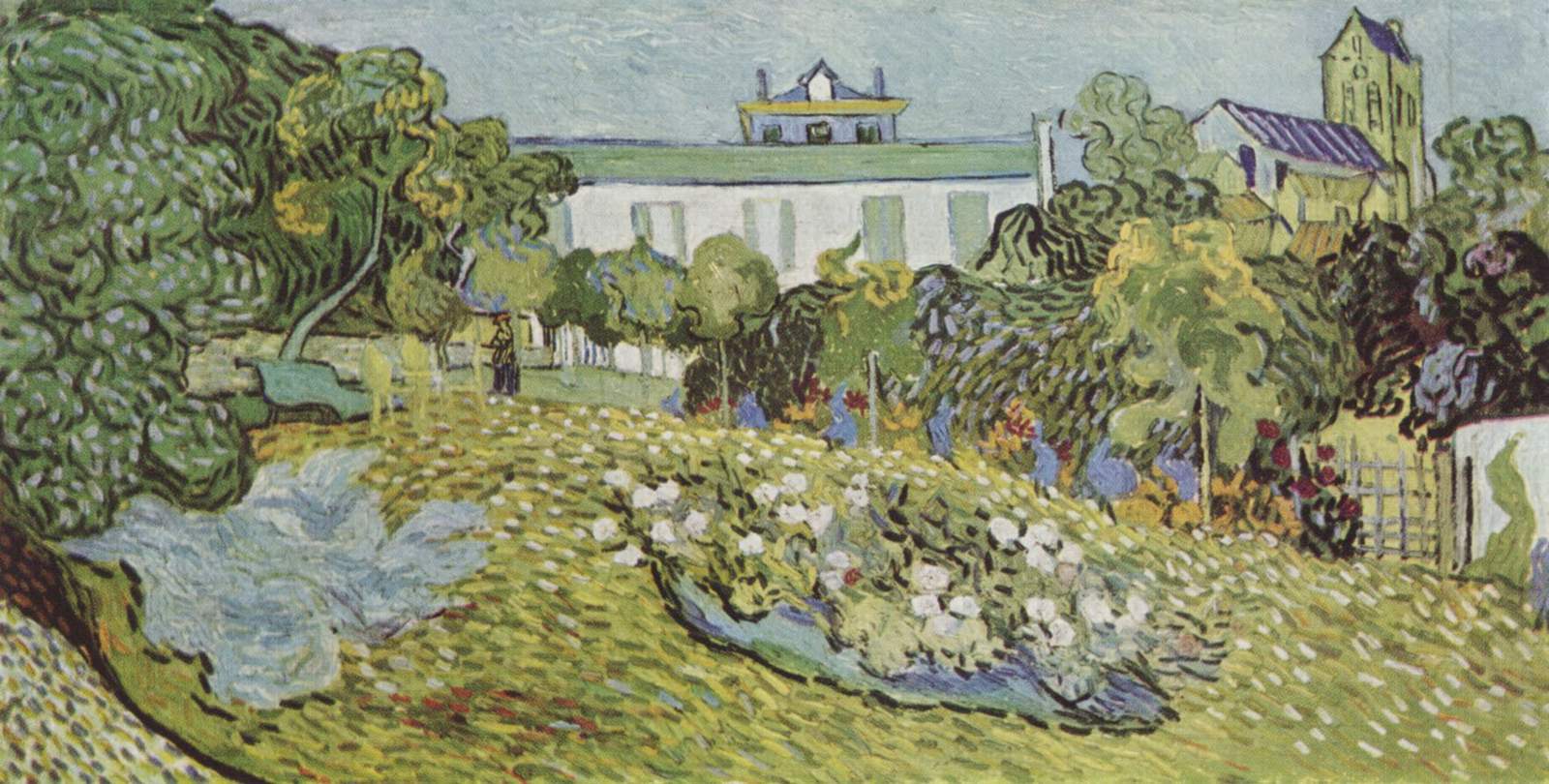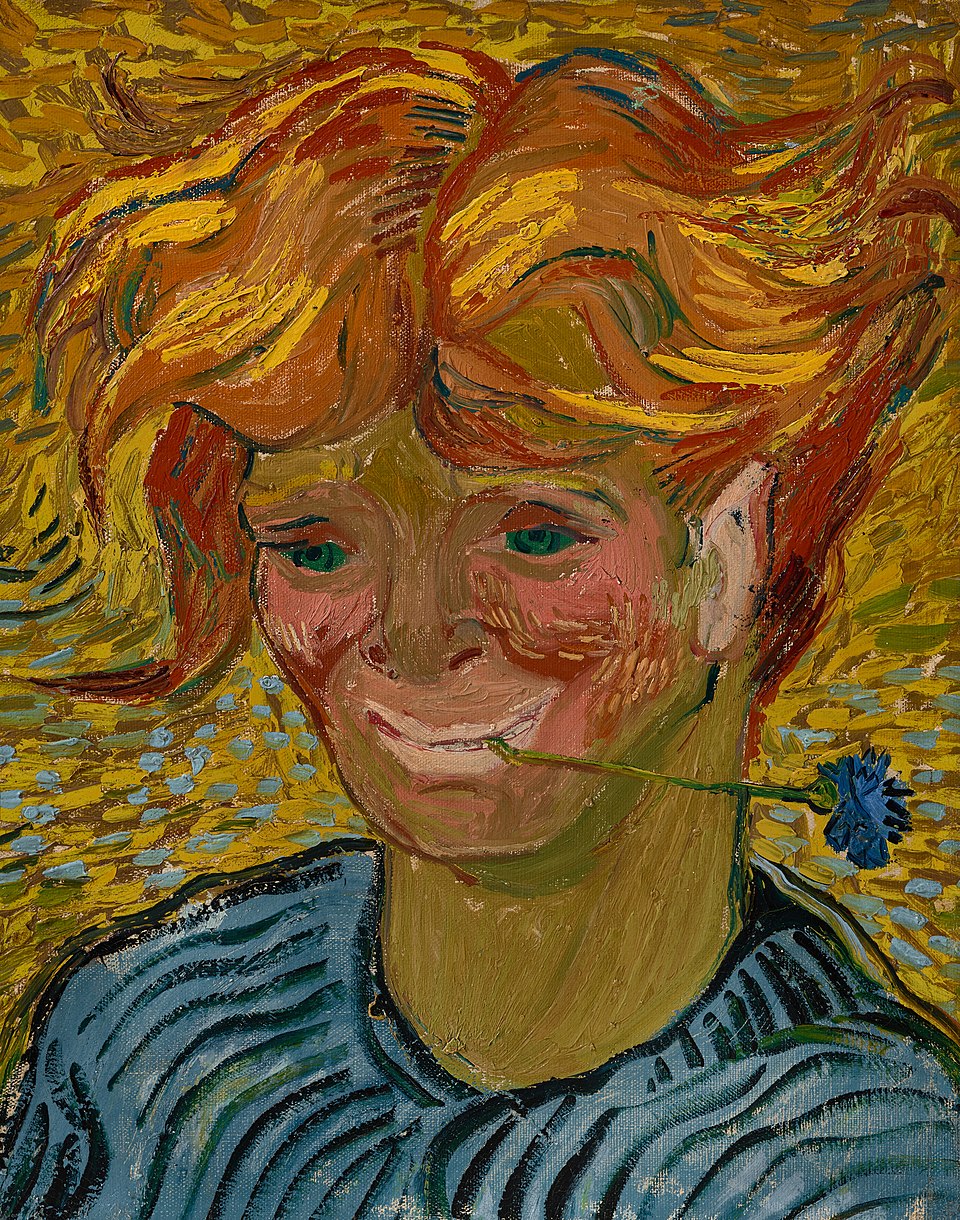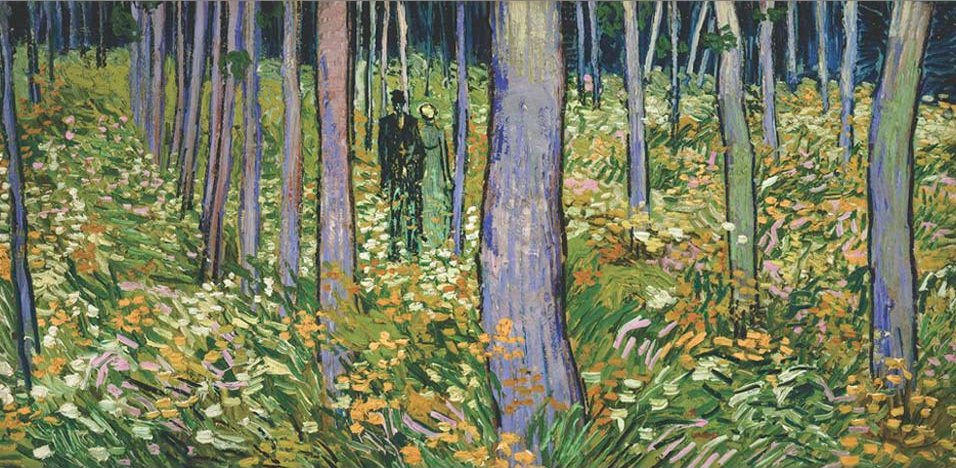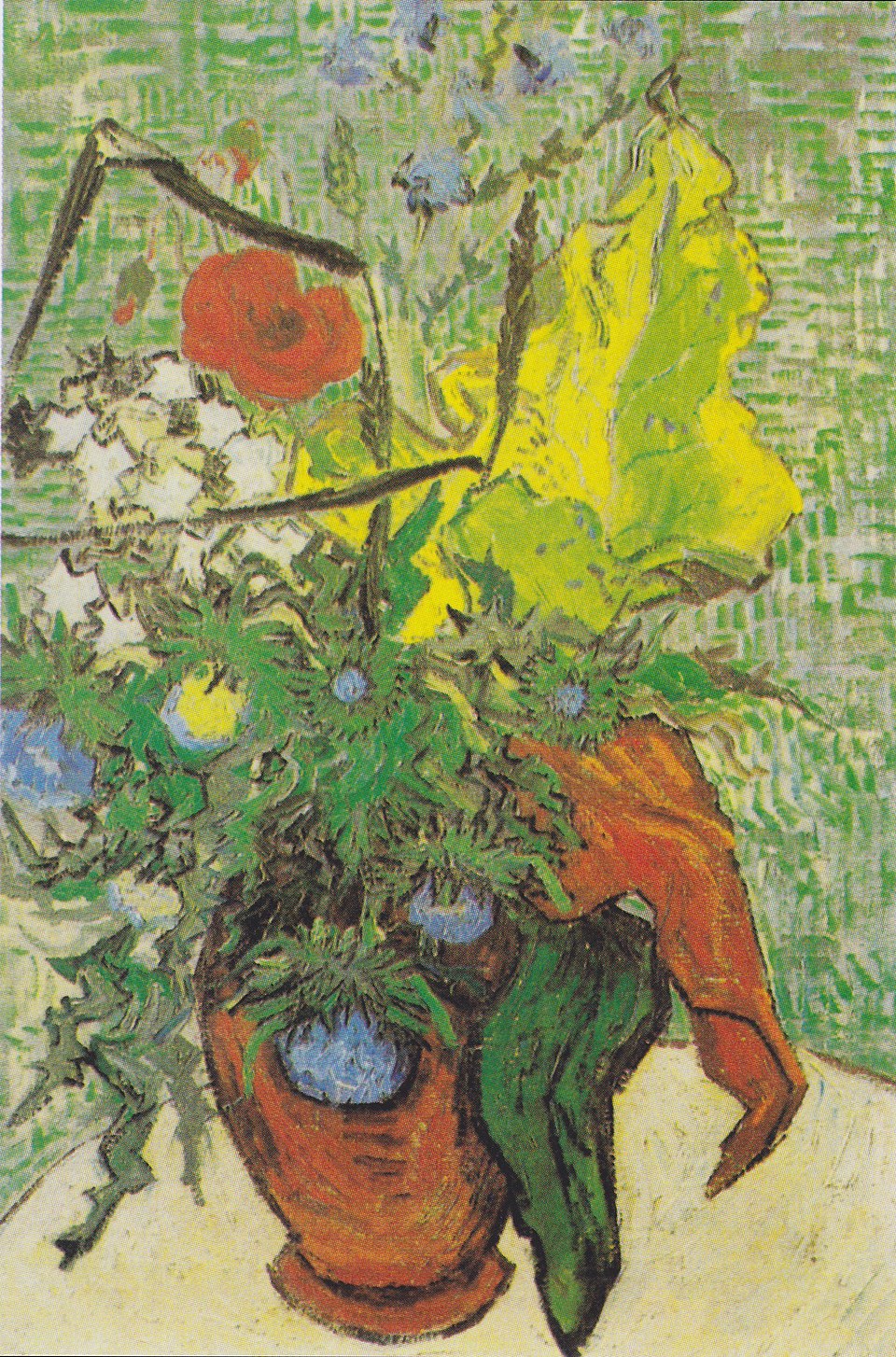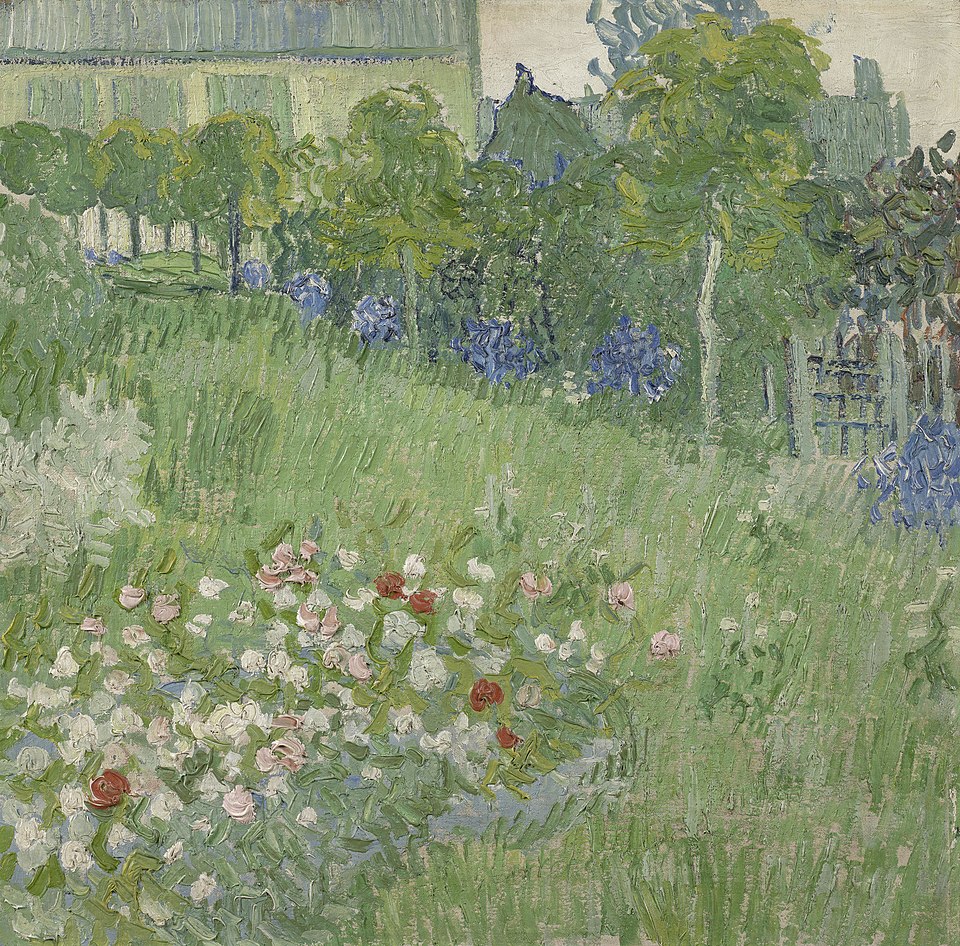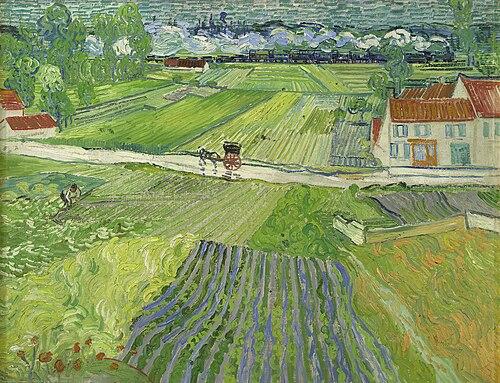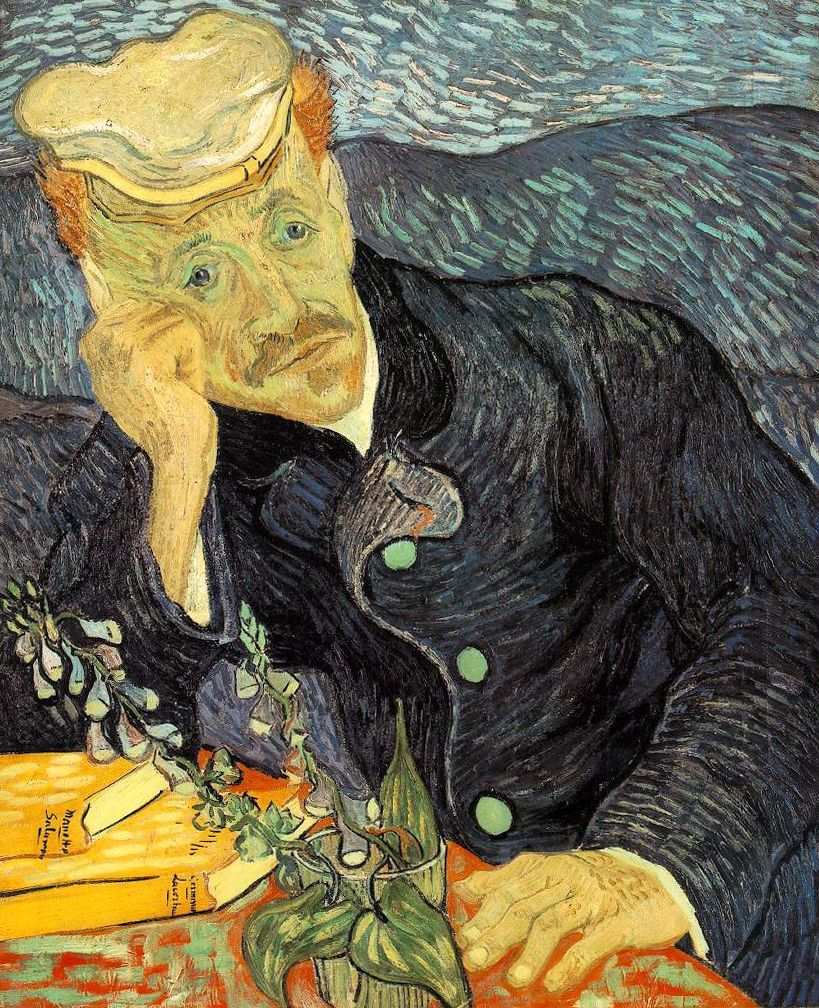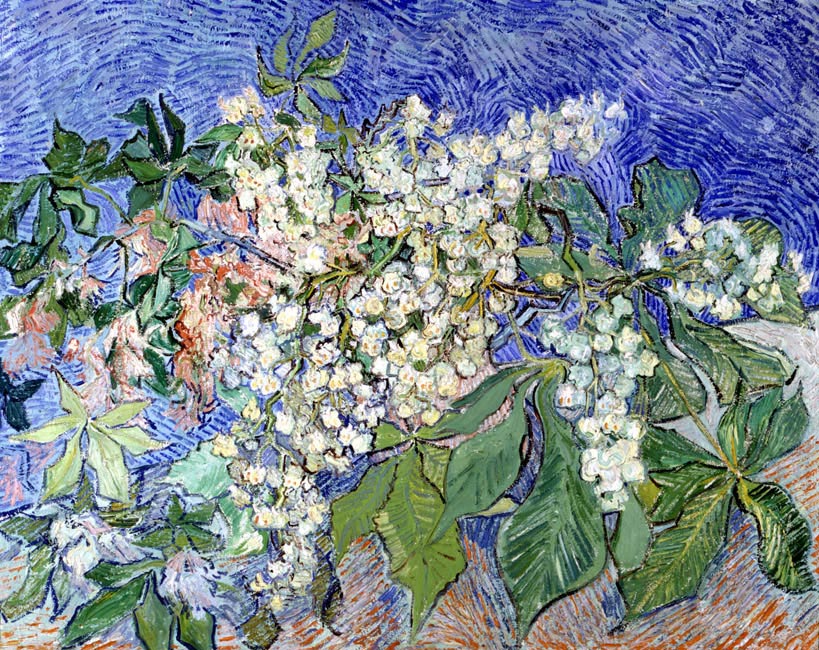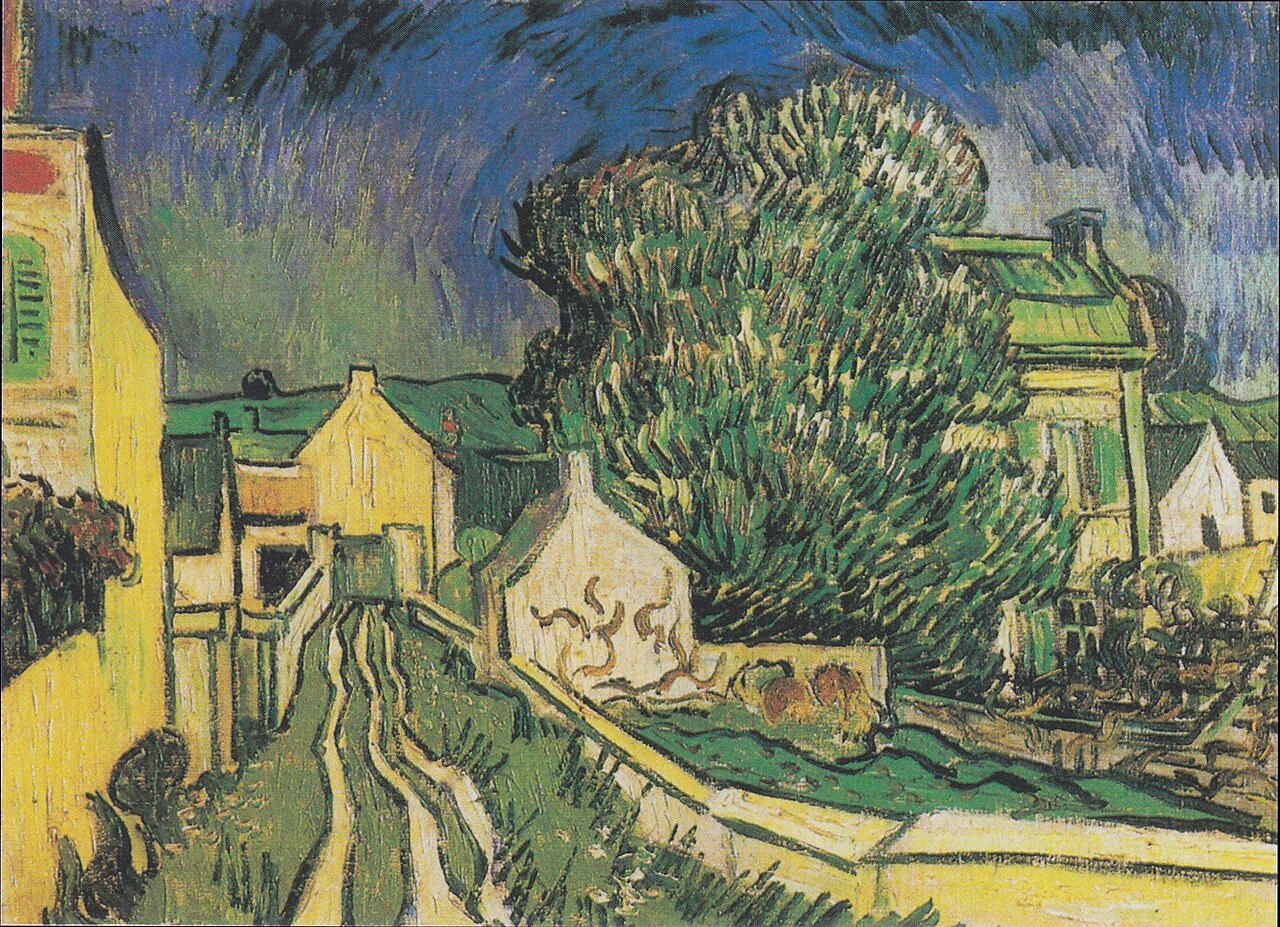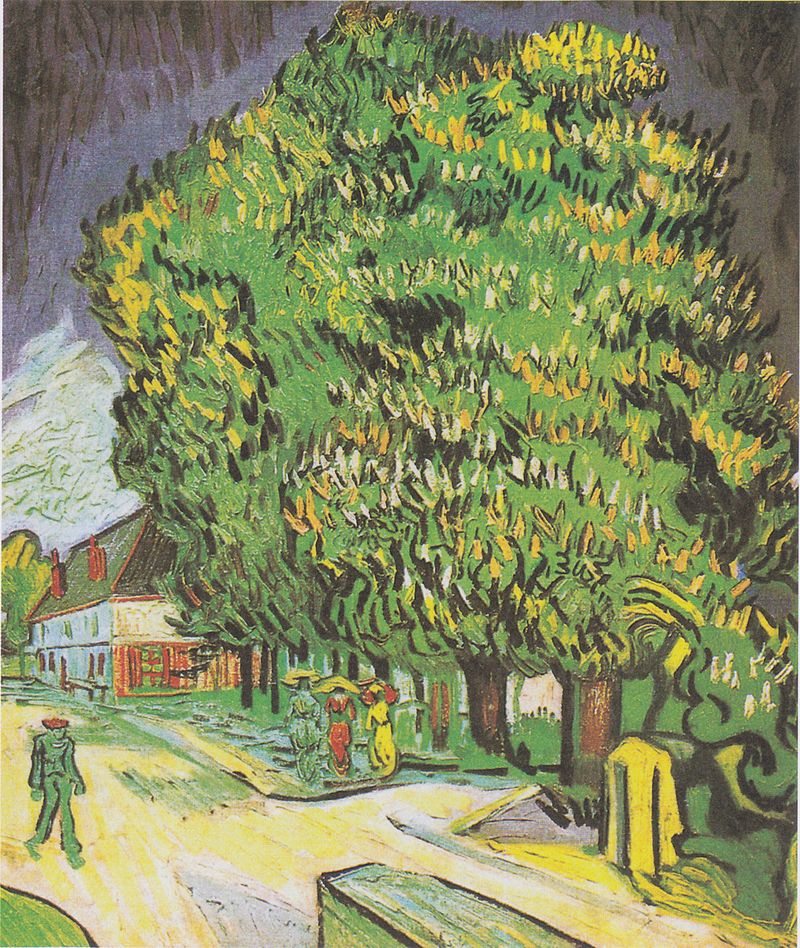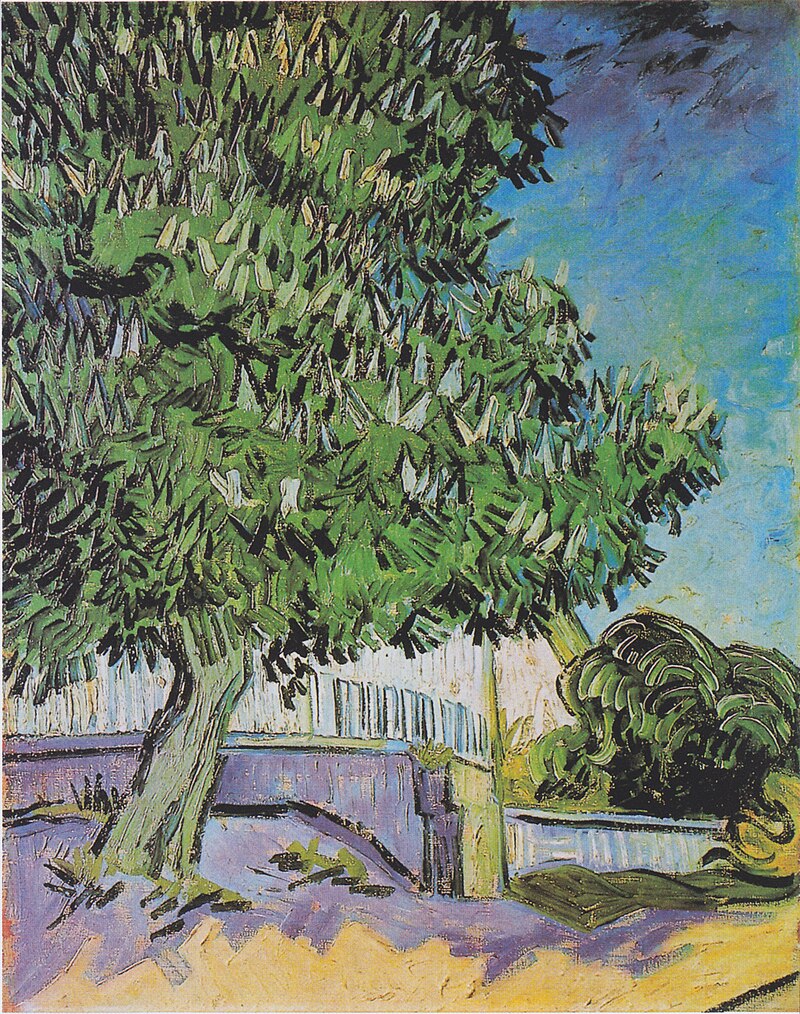Auto van Gogh
083. Grand paon de nuit
La Petite Nature bourdonne et volète autour de ma silhouette. Parfois, son trop-plein d’énergie l’envoie se perdre dans le pan de ma veste ou se cogner contre ma peau. Les insectes, mouche, abeille ou moucheron, en repartent tout étourdis, la trajectoire un peu ivre. L’animation du jardin touche à sa fin. Là-haut, le soleil tire la couverture à lui. Petit à petit, il s’enfonce sous l’horizon et se mue en une orange flamboyante.
Aux prémices de la nuit, la Petite Nature revêt le masque adéquat. Les uns se trouvent un nid tandis que les autres en surgissent. Planté au milieu d’un jardin, j’observe le roulement de cette classe ouvrière naturelle.
Gros comme un poing, le paon, qui n’en est pas un, se dépose à mes côtés. Ses quatre yeux, peints sur ses ailes velues, me fixent intensément. À croire que le petit être tient une prédiction au bout de ses antennes. Puis, il reprend son envol d’un battement d’ailes, dans un froissement dru et épais.
Je m’allonge dans l’herbe humide, un brin d’herbe glissé entre les lèvres, la tête contre mes bras tirés en arrière. Mes yeux se déposent sur le ciel. Je quitte le vert pour rejoindre le dégradé bleu noir qui s’apprête à accoucher d’étoiles. Je guette le premier scintillement, le premier phare extraterrestre.
03 février 2026
082. L'Iris
Une odeur réconfortante habite l’appartement ; une odeur joyeuse et crépitante ; une odeur de cendre. Un feu dansant dévore les bûches dans le foyer. Le bois craque à intervalle régulier. Les chaînes carbonées se brisent, les molécules se subliment et s’oxydent. Les gaz montent invariablement en fumée et là-haut, une longue traînée se dessine au sortir de la cheminée. Ce parfum se marie à la rigueur de l’hiver, à l’épaisse couche de neige déposée la veille. Le ciel a déversé ses flocons dans la nuit, dans le silence absolu et curieux de la ville. Un bon 40 centimètres isole chacun chez lui/chacune chez elle. L’urbain se reconfigure en désert, un arctic bétonné tout juste recouvert.
Alors, sans surprise, épousant l’habitude et le moindre effort, je me tourne vers le couloir. Suspendu sur le mur du fond, brûle un feu d’une autre envergure, un incendie de verdure, une concurrence à la flamme ocre, un vert émeraude et chaud. Au cœur de la toile, un cœur envahit toute la toile. Ses traits puissants dessinent l’intensité et l’âme vivante du végétal. L’iris bleu et royal. L’herbe m’évoque des lignes de champ, le magnétisme, leurs boucles infinies et les équations complexes de Maxwell. Point d’électricité floral, point d’étincelle née d’une intensité, d’une tension ou d’un électron. Peut-être au plus profond du noyau cellulaire certes, mais à la loupe macroscopique de mon regard naïf, rien de cette complexité naturelle n’apparaît.
Je m’assieds aux côtés de l’iris. Je prends soin de ne pas le déranger. Je l’écoute chanter, patient et attentif. Je me réjouis de sa note unique, une harmonique fragile comme un doigt effleurant la corde du violon au-là de la troisième position. L’iris me salue et me convie à partager la quiétude de son royaume.
La paix, ici, toujours, unique.
02 février 2026
081. Jardin de l'hôpital Saint-Paul
Les longs dimanches se transforment inévitablement en journées courtes, fugaces, presque spectrales. Le temps nous échappe d’autant plus que l’on redoute son écoulement. La promenade dominicale se résume à un long chemin, simple, rectiligne, l’objectif en ligne de mire ; quand bien même celui-ci serpente, monte et descend au gré des vallées sur des mille et des cents. Au terme, le souvenir peint seulement une allée de jardin dans le palais mémoire, un bout de terre le long de l’asile, une verdure fraîche et des arbres fleuris, mâtinés d’une couleur chair. Derrière, le bleu mélancolie, l’ondoiement de la nostalgie, une tristesse vissée au cœur qui ne décolore jamais ; elle creuse, creuse, creuse en profondeur, du clair à l’obscur, le bleu convoque l’âme et son miroir. À travers lui, le reflet timide où se forge l’espoir.
01 février 2026
080. Coin dans le jardin de Saint-Paul
Le tableau a dégorgé. Les couleurs ont fané. Il ne reste que le contraste entre le trop-plein et l'absence. Pourtant, assis sur ce banc au cœur du jardin, j'imagine la richesse des lieux envahir mes sens, gorgé mes pupilles de pigments, de tons, de teintes, de subtilités intenses, de la vie sous les bois, à l'ombre des anciens vénérables. La couleur absente, le son aussi refuse de montrer sa présence. Le noir et le blanc imposent un curieux silence, comme un coin d'univers dépourvu d'étoile. Éole ferme son claquet. Le bruissement dans la ramure se tait. Les corps se figent. Tout s'immobilise.
Je suis l'exception. Moi, je respire. Je passe par-dessus la flèche du Temps, momentanément stoppée. Je me fais fantôme dans un décor qui tient du spectral. Et pourtant. Pourtant, une lumière intense jaillit et s'en vient enflammer les arbres, percer les ramures, illuminer le sous-bois. Les rayons amènent ces lieux à la frontière de la vie. Il suffit d'un rien pour que le jardin verdisse.
Assis sur le banc, j'imagine ce rien, ce fragment de manque et sous mes paupières fermées, la Petite Nature et ses harmonies resplendissent.
31 janvier 2026
079. Le Buisson de Lilas
Je continue mon voyage, de toile en toile, sans passer par l’appartement. Je le délaisse quelques jours, m’abandonne au ciel de Provence, au soleil d’autrefois, aux éléments d’un temps où l’huile et le moteur n'existaient pas. Je marche, je marche, je marche. Sur le sentier, un buisson, un Lilas clair, pas un blanc, un mauve, doux, floral et parfumé. L’air embaume le buisson printanier. Je m’en nourris et un sourire s’en dessine. Autour, la Petite Nature s’anime. Les cigales, les grillons et quelques oiseaux sculptent une bienheureuse forme d’harmonie.
Le Lilas escorte le sentier. Il joue au Sphinx, je m’attends à répondre à une énigme, une devinette classique sur le nombre de jambes. Peut-être, tout sympathique, me laissera-t-il passer après un brin de causette et rien de plus terrible. Le buisson a fière allure, mais une solitude lui pèse. Le reste du règne se hisse à peine à ses pieds. Il compense en taille et en densité. Il affirme sa présence, conquiert le tableau, prêt à sortir de la toile, la percer, rejoindre ma propre matérialité.
Une rivière dorée borde le sentier, sur l’autre rive, à l’opposé du Lilas expansionniste. Son estuaire semble s’ouvrir sur le ciel. Son lit embrasse les nuages et l’or transmute en étoiles. Le ciel sombre s’éclaire à l’aura du Lilas. Jusqu’au sommet, le buisson fait sa loi, impose les couleurs, les formes et les humeurs. Le diktat du Lilas, voilà un titre adéquat. À l’échelle individuelle, ses éléments autoritaires, il suffit de les contourner, de les abandonner à leur misère. L’illusion de leur attractivité ne dure jamais. Jamais une pensée artificielle ne s’enracine, bien au contraire. D’un zoom moins resserré, les considérations se complexifient. D’autres mécaniques s’emmêlent, plus difficiles à gripper car le collectif devient nécessaire. Mais peut-être ai-je tort ? Les dynamiques se font souvent plus complexes que de prime abord.
Pauvre Lilas. Comparaison peu flatteuse. Il ne la mérite pas. Je hume une dernière fois son parfum printanier et le contourne lentement pour découvrir les prochains pas de mon errance. Le buisson se montre élégant, poli et gentilhomme même. Il me souhaite de cueillir le fruit ardemment désiré, cette pomme de connaissance contre le déclin des évidences.
30 janvier 2026
078. Iris
L’appartement gémit. Le bois travaille. Les lattes du plancher craquent. Dehors, le froid envahit rues et ruelles, les transforme en parfaits déserts. Pas une âme ne se risque à y pointer le bout du nez. Une bruine l’accompagne partout, presque invisible. L’ocre des lampadaires trahit sa présence. Sous leur lumière dorée, l’humidité scintille, à la lisière du cristal et du givre. Enroulé dans ma couette, un nouveau parfum se fraye un chemin jusqu’à mes narines endormies. Des fragrances provençales évoquant des champs de lavande. Je me tourne vers le long couloir, vers le pan qui s’orne de la toile. Oui, c’est bien cela. Une période achevée, un lieu terminé. Je remonte le temps d’un cran. Désormais, je rejoins le Maître sous le ciel de Provence.
Et pour entamer cette renaissance, un parterre de fleurs, un modeste sujet en apparence, mais une parfaite maîtrise de la couleur. Les iris s’épanouissent. Leurs pétales se défroissent et s’étirent, forts de l’intensité de leur pigment. Ils en connaissent la profondeur. Ils en soupçonnent les recoins insondables. Leur bleu abrite des abysses, des mers, des océans. Certains affirment même qu’il ouvre un portail sur des contrées spatiales, des lieux d’univers situés à des années-lumière.
Un iris fait le malin. Lui a décidé de se vêtir immaculé, ignorant le code vestimentaire envoyé la veille au matin. Ou alors, le pauvre se réveille tout délavé, perdu, incapable de comprendre les raisons d’un tel sort. Derrière, des colonies florales se pâment d’ocre et de feu. Elles réchauffent et rehaussent les iris marins. Les verts jouent aussi leur partition. Chacun suit les directives du pétale le plus proche : un vert froid, comme couvert de neige au pied des bleus ; un vert tendre et vif sous les couronnes de feu.
Je décide de poser mes pénates ici pour le reste de la journée, de profiter des heures de cette promesse d’été, du chant de la Petite Nature renouvelé. Je ferme les yeux et me laisse envahir. Je renouvelle mes sens, les guéris de l’abrasion causée par la ville et leur applique le baume chaleureux des présences primordiales.
29 janvier 2026
077. Gerbes de blé
Des chapeaux s’alignent dans le champ au pic de l’été. Des chapeaux étranges, ligotés d’un lacet au sommet. Ils ont l’apparence d’une espèce extraterrestre, d’un groupe d’inconnus ayant fait escalade par erreur sur notre planète. Les gerbes se teintent de gris. Des traits leur courent des pieds à la tête et s’étendent jusqu’à dessiner leur ombre arrachée au soleil. Les monticules penchent d’un côté ou de l’autre, tristes, un peu misérables et défaitistes. Pourtant, la couleur dément cet état d’esprit. Une force les habite, une richesse qui annonce de beaux lendemains. Mais pour qui ?
Mon dernier champ à Auvers. Jamais plus je ne foulerai la terre labourée, ensemencée et récoltée par des paysans chevronnés. J’en foulerai d’autres, ailleurs, sous le soleil de Provence, sous la grisaille hollandaise. Les couleurs présenteront un autre visage, parfois d'une intensité différente, parfois d’une palette bien plus singulière.
Je serpente entre les gerbes et j’y pense, à la pousse des blés. Je refais le film tout entier. Sous mes yeux, le temps s’inverse et fait un bond en arrière. La terre nue, labourée, les graines plantées, jetées à la bonne volonté de la Petite Nature. “Tiens, travaille déesse antique”. Le soc et le bœuf pour aérer la terre. La mécanisation attend encore patiemment son heure. La marée noire n’a pas encore empoisonné l’entièreté des terres.
Je reviens au temps qui est le mien, le fantasme de l’époque toujours vivace. Je romantise ces années lointaines, inconnues même. Mon ignorance me charme davantage que les perspectives présentes, la frénésie et la fureur à tout prix, le bruit constant, la montée des courbes au risque de la vie. Je ne retrouve pas la beauté des tableaux d’hier dans la lumière d’aujourd’hui. Au fond de moi, j’espère simplement ne pas regarder au bon endroit.
28 janvier 2026
076. Les champs de blé avec Auvers en arrière-plan
J’approche de la fin. La fin d’une étape. La fin du village. La fin d’Auvers. Bientôt, je m’y rendrai pour la dernière fois. Je visiterai encore ses champs de blé, ses récoltes, son labeur et ses paysans. Un au revoir en quatre temps. Pour l’heure, je m’apprête à l’appartement. Je me pouponne. Un coup d’eau et de crème, un coup de peigne. J’essaye de me faire beau, de présenter un visage défroissé au tableau. Ces derniers jours, je me laissais aller. L’approche de la ligne d’arrivée m’oblige à y remédier. Je refuse que le village se souvienne de moi à cette image, un petit gars mal dégrossi, le vêtement troué et la figure bouffie. Aujourd’hui, je m’applique avec soin.
Je surgis parmi les blés. Je passe la porte des mondes au cœur de la marée dorée. À perte de vue, elle engloutit le monde. La promesse du pain qui dominera l’alimentation, qui nourrira le monde. Le champ a une épaisseur presque grossière, loin de la finesse des épis sur le seuil de l’été. Le Maître les a gavés de gros traits et a conservé le doigté à mesure qu’il s’élevait vers les hauteurs, le long des murs et des toitures villageoises. La Petite Nature serait-elle donc encombrante à son regard et les faits de notre espèce délicats ? J’en doute. Voilà seulement un malheureux hasard.
J’erre à travers les céréales. Elles s’écartent poliment. Je prends garde à ne pas les écraser. J’emprunte les sillons du détenteur de la clé des champs. Toujours un coup d'œil au ciel. Toujours l’envie d’y grimper au coin de la tête. Un ciel discret, un mauve léger, un bleu absent. En remontant le temps, en descendant vers la Provence, je trouverai des ciels d’envergure, des profondeurs azur que peu de Maîtres ont égalés.
27 janvier 2026
075. Vue sur Auvers avec champ de blé
Le silence hante l’appartement. Le bruit provient de l’extérieur seulement. L’écoulement des eaux usées dans les canalisations ; le métropolitain et son vrombissement souterrain ; les usagers urbains déambulant sur l’asphalte piqueté de flaques orangées. J’ouvre fenêtre et volet. Je hume la densité de mes congénères avant d’allumer une cigarette : un remède autant qu’un poison. Derrière moi, j’entends les couleurs babiller. Le tableau s’éveille. Il entonne sa litanie quotidienne. L’amour de l’errance y répond immédiatement. Je referme volet et fenêtre d’un geste sec. En silence, j’enfile ma panoplie pour le voyage : des chaussures de marche, éprouvées, un pantalon épais, une cape à l’épreuve des baisers d’Éole comme d’Hélios.
À peine atterri, je m’enfonce au milieu des blés dorés. Les épis envahissent la toile, prêt à dévorer la ville. Je les imagine, tels lierre et liseron, ramper le long des murs, s’enrouler autour des arbres, recouvrir les pierres ; le village deviendrait : Auvers-sur-Blé.
Les couleurs contrastent, se marient et se relient. Tout cela à la fois. L’or et le mauve s'excluent, mais le vert les relit. Il fait office de négociateur, il harmonise les humeurs, guide ses sœurs à faire un pas l’une vers l’autre et propose, modestement, une réconciliation au moins au sein du tableau. Les deux fauves, le froid et le chaud acceptent de mauvaise grâce et continuent malgré tout de se toiser. Sur les toits, le mauve domine, toise davantage que le blé ne saurait en rêver.
Le mauve a pour lui le domaine céleste, la silhouette des nuages, des panaches de fumées gorgées d’eau et de neige. Bien sûr, pas de neige estivale, mais à ces altitudes, je devine la beauté du cristal.
26 janvier 2026
074. Meules de foin sous un ciel pluvieux
Le crépitement de la pluie envahit les champs. L'humidité s'infiltre jusqu'au creux de l'os. Le ciel pleure depuis longtemps. Les herbes s'agitent nerveusement sous les caprices du vent. Un coup à gauche. Un coup à droite. Une caresse. Une maladresse. Éole siffle sans cesse le chaud et le froid. Je patauge sur le sentier à peine gravillonné, la boue jusqu'aux chevilles. Pieds nus, le froid me gèle les orteils. Immobile, j'attends sous le rideau, les gouttes s'écrasent contre mon crâne en flaque. Je fixe la meule de foin, puis balaye les verts d'un trait avant de me perdre dans les nuages, le troupeau céleste. Des oiseaux bravent la tempête. Stoïques, ils laissent le vent imposer le cap. Enraciné dans la glaise, je rêve de m'enlever, d'épouser le vent à leur manière, de toiser l'horizon, de ne plus jamais le qualifier de lointain ; que le voyage et la destination ne fassent plus qu'un.
25 janvier 2026
073. Les champs
Je respire. La cadence ralentit abruptement. Les sirènes s'éteignent. Les urgences se reportent au lundi suivant. Enfin s'épanouit le week-end. Ce matin, aucun réveil ne résonne dans l'appartement. Le ronronnement de la ville se fait plus doux dehors. L'agitation urbaine, réduite de moitié, n'a plus assez d'énergie pour frapper au volet. Ailleurs sur Terre, d'autres demeurent en apnée, le fer de Damoclès suspendu au-dessus de leur tête. Chez eux, le ronronnement se fait toujours tonnerre et l'orage ne cesse de déchirer le ciel. Les vieilles frontières arbitraires et d'intérêt décident de leurs malheurs ; ça et les immondes vices de vieillards rabougris.
Des champs. Encore. Je ne m'en lasse pas. Des carrés cultivés à perte de vue, épousant la rondeur des collines, leur offrant un peu de volume. Ici et là, un arbre agrémente le relief, une petite tour d'observation végétale pour guetter alentour. Le mélange des couleurs produit une douce saveur, de l'or, de l'ocre, du vermeil, du vert. Un gris pluie s'invite encore. Une étrange traînée s'étend sur la prairie, comme une flaque d'eau ou un fin nuage.
Le ciel se prépare encore à filer la pluie. Les épaisses cordes attendent patiemment, calfeutrées dans le coton des nuages. Le signal de la dépression se fait attendre. Mais bientôt, elles claqueront fort, dégringoleront et dessineront un épais rideau. En attendant, je poursuis mon errance, le col zippé jusqu'au menton, le parapluie dans une main, l'autre dans la poche de mon pantalon en lin. Je longe le chemin. Aucune destination particulière. Je recherche seulement la quiétude des lieux, le silence humain et l'absence de furie des empires.
24 janvier 2026
072. Champ de blé avec bleuets
Une courte ellipse aujourd'hui. Un fragment. Rien de plus. Je profite du vent, de l'humidité grimpante, de la synthèse des éléments. Le vent rugit dans mes oreilles. Avec lui, s'amène la tempête. Là-haut, les nuages s'amoncellent. Les moutons s'apprêtent à bêler. Bientôt vient l'heure de la tonte. Je devine des formes à travers le contraste des gris. Des dragons appelés zéphyr. Les fleurs et les montagnes revêtent la même couleur, le bleu mélancolie des esprits maladifs. Un bleu marin. Un bleu pas si lointain.
23 janvier 2026
071. Champ de blé aux corbeaux
Au milieu de la nuit, calfeutré à l’orée du silence des respirations dormantes, mes larmes ont coulé. Au pays des songes, l’expédition touchait à son terme. Le périple avait été rude et terne. Devant nous, un portail se dressait. Il marquait la fin du voyage avec ses barreaux rouillés et humides. Le sel se déposait sur mes joues, comme les embruns d'un torrent. Ma respiration s’accélérait. Mon nez s’encombrait. Dès lors qu’il fallut respirer par la bouche, je me réveillai.
Au pays matériel, un silence léger, ponctué des sirènes autoritaires, du tumulte naissant de la ville dont la paupière se soulevait. Les gyrophares perçaient à travers mes volets délabrés, dessinaient des ombres curieuses, des silhouettes impossibles. L’agressivité urbaine pénétrait dans l'appartement. Je sentais les murs frémir à l’idée de s’y confronter une journée de plus. Peut-être la dernière, craignaient-ils. Le lieu mit de lui-même en évidence la toile. Le néon s’alluma, solitaire, au bout du couloir. Respectueux des traditions, fidèle au culte des appartements divinisés, je me levai, la figure fripée, la peau marquée par mes draps sales et me dirigeai, le pas lent, mais déterminé, vers le plus beau spectacle des champs qu’il m’ait été donné de contempler.
Un genre de tourmente. Une vision surimprimée. Un prisme noir. Le vent siffle fort, terriblement fort. Là-haut, le ciel prépare l’orage. Les corbeaux ajoutent leur ramage avant de s’envoler dans un froissement d’ailes. Les blés grincent, trop secs pour se laisser aller. Les nuages, fluorescents, se griment en lune, décorent le ciel d’un paysage stellaire inconnu. L’obscurité troue la voûte d’épais traits, elle le creuse en des profondeurs inconnues d’où jaillit l'indicible espace lointain.
Les routes s’éloignent, chacune offrant un futur possible. Je me tiens sur le point de non-retour, l’ultime nœud, l’orée du destin. Aucun des tracés ne m'inspire. Je n’en devine pas la finalité. Le voyage compte certes, mais il est bon de savoir où l’on pose le pied. Alors, prudemment, je me détourne des trois évidences et d’un pas lent, je creuse ma propre ornière, car je sais que dans cette direction j’atteindrai un jour la mer.
22 janvier 2026
070. Chaumières à Chaponval
Les chaumières s’arrachent à la terre et forment des tumulus pointus. Le chaume de la toiture se fond dans la prairie, seule la couleur trahit le vivant du sec, du desséché, du depuis bien longtemps coupé. Ces bâtiments en imposent, elles dévorent le cadre, l’envahissent d’un bout à l’autre, l’air de dire : j’habite ici. Au sommet de l’une d’elles, une silhouette et une échelle. Une main attentionnée, un esprit prévoyant qui saisit l’initiative au bon moment, avec au terme de la bobine de pensée : ici il faut réparer.
Une paire de silhouettes papotent sur le seuil, l’une bleue, l’autre brune. Des petits formats, des formats jeunesse, des jeunes à l’énergie solaire. Ils profitent du bon temps, du temps de repos, de se reposer entre les labeurs de la vie villageoise. La porte d’entrée de la chaumière s'entrouvre, une lumière incandescente s’en évade, un ocre chaleureux né d’un foyer animé.
Au fond, un corvidé guette, perché sur la corniche de la bâtisse arrière. De temps en temps, il croasse, rappelle aux bipèdes qu'il sait donner de la voix. Augure depuis sa naissance, l’emplumé prophétise du haut de sa prestance. Ses prédictions se veulent précises, au cordeau des futurs pressentis. Malheureusement, mon genre ne comprend goutte à la langue des corbeaux. Comme dans les tragédies, ses prédictions restent lettre morte et la Roue du Temps embraye vers son sinistre cycle. Un oiseau nommé Cassandre.
Je me console dans le bleu-gris-vert du ciel. Les nuages me bercent. Ils n’annoncent pas encore la pluie. J’en profite pour cueillir un coquelicot ici et là, quand le genre humain détourne le regard et continue d'ignorer la présence d’une âme venue en quête de paix.
21 janvier 2026
069. Deux femmes à travers champs
Une fièvre colorée échauffe la toile de la journée. Les espaces se confondent, se mêlent, se superposent. À peine quelques traits délimitent les silhouettes, les sommets et le crénelage émoussé assis sur l’horizon. Les champs pataugent dans une marée vert clair, une fluorescence artificielle, comme si une légion de laitues irradiait quelque photon inattendu.
Sur le chemin, ocre et poussiéreux, deux amies se promènent, l’âge harnaché dans la raideur dorsale, mais la sagesse calfeutrée sous la volonté de respirer l’air d’été. La robe blanche s’oublie vite, éclipsée par ce formidable bleu à pois qui détonne. Le cheveu long, le cheveu roux, la promeneuse se coiffe de paille, complétant le foyer qui brûle au sommet de sa tête. Je laisse ces dames passer. À mon habitude, je reste discret. Je ne veux pas déranger. Je me retiens même de respirer, une courte apnée le temps que leurs paroles s’envolent et que plus aucun sens n’y résonne.
Aujourd’hui, le ciel se fait mousse. Une mousse vivace, verte ou bleue, sans nuage. Je poursuis ma route dans sa direction. Je me demande quelle couleur il me réserve sur l’autre versant des collines. D’abord, je compte faire une halte à la maison dressée non loin, petit pavé d’or solitaire. J’y trouverai de l’ombre sous les arbres, de quoi reposer mes yeux de cette fantaisie colorée, de cette fièvre du pinceau dans laquelle le Maître m’a embarqué.
20 janvier 2026
068. La Mairie d'Auvers-sur-Oise le 14 juillet
L’eau s’écoule à bouillon dans les lits zingués. Les gouttes martèlent les volets qui grincent sous l’insistance véhémente du vent. Dehors, au cœur de la nuit, le monde tourbillonne. Les feuilles s’effritent en nuées, comme une compagnie d’oiseaux prise d’une envie soudaine de tourbillonner. Éole s’égosille en cadence. Sa voix se brise, rafale après rafale, ses mots se soumettent à l’orage. Tout là-haut, le tonnerre gronde en majesté. Les éclairs jaillissent, zèbrent la voûte, la sculptent, lui impriment les fugaces formes de la Nature. Enroulé dans mes couvertures, grelottant malgré le chauffage, mon insomnie se fixe à la cadence des roulements, l'œil en quête du prochain flash à travers la rainure des volets. Au plus fort de la tempête, enfin le tableau m’appelle, une voix légère, parfumée d’été, pleine des couleurs d’une Petite Nature encore respectée.
C’est jour de fête, semble-t-il, à la mairie. Les drapeaux sont de sortie. La brise les agite amicalement. Elle participe de bon gré à l’effort patriotique. La Marie ressemble à une île, unique pavé de mortier enraciner au cœur d’un parc chatoyant, un pré lorgnant davantage sur le jaune des blés que le vert printanier. Peu d’âme s’anime autour d’elle, peu d’embarcations s'amarrent à son quai. Quelques-unes errent le long des courants voisins, battant le pavillon franc, d’autres posent l’ancre sur les bancs, mais malgré sa porte grande ouverte, personne ne pénètre le national bâtiment.
Moi-même, je me tiens en retrait. À bord de mon frêle esquif, je gite, je gite, je gite. Je crains aussi le grain ici. Je profite du soleil et du ciel pastel. Je leur offre mon visage amaigri, épuisé des nuits d’insomnie. Je me laisse bercer par les vagues et la danse des pétales. Les feuillages susurrent des mélodies primordiales. Je confonds terre et mer. L’horizon disparaît et j’en souris, ravi.
19 janvier 2026
067. Le jardin de Daubigny avec un chat bleu
Je n'ai pas bougé. Je suis resté prisonnier du jardin. Mais d'une manière ou d'une autre, la toile a changé. Le temps s'est écoulé. Combien de temps ? Combien d'années ? Quand reviendrai-je à l'appartement ? Quand retrouverai-je le néon blafard et les miettes au coin de la table ? Mes pieds s'enfoncent dans la terre meuble du jardin. L'humidité remonte jusqu'à mes genoux, imbibe mon pantalon en toile. Je m'enracine au cœur de cet Éden rafistolé et fantasmé. Et dans celui-ci, point de serpent, un chat bleu passe seulement.
La lumière ondoie sur le ciel comme en mer. Des traits or et pastel sur un aplat bleu, légèrement vert. Une ligne fractionne le ciel. Un côté sombre, un côté clair, entre les deux : cette frontière. Curieuse dualité céleste. Aujourd'hui, les arbres se dressent plus droit que la veille, du moins leur tronc acquiesce une raideur militaire. Les ramures conservent une certaine folie ondulée, tourbillons de feuillages nervés.
Des détails se précisent, apparaissent, ressortent à la lumière nouvelle. Un banc, une table, des chaises, un portail, une silhouette fine. Le jardin s'agrémente de petits plaisirs. Derrière, un long bâtiment coupe le ciel, le crépis rose, le mur bardé de fenêtres. Et un peu plus haut, une sorte de tour en guise de chapeau, blanche, le toit ardoise, deux piquets pour délimiter le bout des arrêtes.
Le jardin a perdu de sa splendeur. Couleurs et fraîcheur se sont affadies. Il règne une humidité lourde, une empreinte spongieuse caractéristique d'une violente ondée d'été. L'air chaud étouffe presque, gorgé d'eau et de la violence rémanente des éléments. Je pourrais rester. Je pourrais m'asseoir sur le banc, à la table ou encore passer le portail. Je passe mon tour cette fois-ci. Je rentre.
18 janvier 2026
066. Le Jardin de Daubigny
Ce matin, je me réveille en terre étrangère, loin de ma maison, dans un duché lointain qui ne borde pas le lit du Rhin. La locomotive me presse, l’horlogerie s’anime sous la cadence des aiguilles. Tic tac, il me faut partir. La vapeur s’élance et force les turbines. La mécanique grince, couine, rugit. Je cours après elle. Je déambule de nuit à travers la ville. Je me repère aux fumerolles s’échappant évasives des cheminées d’acier. Les rues dorment encore. Les rêves n’ont pas encore été jetés sur le palier de la porte. Et pourtant, si loin de chez moi, la toile s’invite. La peinture crève la réalité. Elle suspend le temps et grippe les mécanismes ferroviaires. L’entropie rentre en apnée. Les molécules se figent pendant que la flèche du Temps se rétrécit. L’instinct me pousse à l’exploration, à abandonner une nouvelle fois ma première destination.
De l’obscur au clair, je transite. J'atterris mollement sur un tapis floral, un jardin parfaitement garni. La saison y est propice, la sueur et le labeur aussi. Les herbes s’ajustent à la hauteur désirée et dessinent un horizon dentelé de pétales. Les arbres ondoient, du tronc jusqu’au bout des ramures. On les croirait atteints d’ivresse. Je fabule. Je délire. Peut-être. Loin derrière, l’église se dresse. Elle présente sa nuque, nous dissimule son visage, comme l’avatar d’une religion où le blasphème se niche dans la représentation.
Le ciel, encore lui, accroche mon regard, mes pupilles dilatées encore nostalgiques de la nuit. Des traits composent la voûte, un mélange de pastel de toutes sortes, claires et douces. On croirait un simili gris. Moi, j’en suis convaincu, j’arpente un jardin sous une aurore fraîche et porteuse d'un espoir précieux.
17 janvier 2026
065. Champs de blé après la pluie
Après tout, peut-être que la fuite colorée de la veille marquait la pluie, un rideau épais, des cordes drues, le fracas des gouttes martelant la terre. Ma mémoire me fait défaut. Je ne me souviens plus si mon manteau dégoutait, si la pluie se mêlait aux larmes grises.
Aujourd’hui, un coup de vent a balayé le noir et blanc. Les couleurs ont éclos comme au printemps, fraîches, intenses dans leur renaissance. Le paysage apparaît lavé, rincé, mais pas encore séché. Une pesanteur humide imbibe encore l’atmosphère de la plaine. Quelque chose de frais et non putride, une forme de jeunesse, une sorte de promesse, un rien des éléments laissés à la discrétion des vivants qui dit : profite de l’instant présent.
Je prends la note au pied de la lettre. Chaussé de mes bottes hautes, je déambule dans la contrée. Je monte et descends les maigres reliefs. Je traverse les champs. Par esprit, je défile à travers les saisons. La Petite Nature s’éveille. Elle compte bientôt finir sa toilette. L’ondée l’a surprise. Elle ne s’attendait pas à ce que le ciel se déverse ainsi. D’abord, il faut réparer, tout reconstruire. Ensuite viendra le temps de chanter, d’animer les herbes hautes, de rappeler à ceux d’en haut que ceux d’en bas existent.
16 janvier 2026
064. Les champs de blé
La couleur répond aux abonnées absentes. Elle roupille quelque part, à l’abri du dictat des réveils et du soleil. Elle abandonne le monde, le prive de sa palette. Elle le condamne au non-chrome, au noir et blanc, à l’absence de longueur d’onde et à l’empilement du spectre. Plus de nuance entre les teintes, seulement entre les gris. Des dégradés plus subtils, plus délicats à transcrire. Le contour des formes s’annonce incertain, la nature du sujet, bien que familière, ne coule plus sous l’évidence. Un paysage. Un champ. Des blés. Un ciel de traits où une ondée pourrait menacer.
Une certitude. Un désert. Une absence de mes congénères. Je plante seul mes pieds au milieu des champs décolorés. Personne ne travaille à repigmenter faune et flore. M’est avis qu’enfermés à double tour chez eux, ils trépignent à la recherche de la substance manquante.
La disparition des couleurs ne condamne pas la Petite Nature. Au contraire, elle redouble d’efforts pour marquer sa présence. Le vent redouble de force. Il accélère le rythme de la danse. Les herbes et les blés donnent de la tige, ondulent, frémissent et se murmurent le refuge des couleurs. Un secret bien gardé, à l’abri des miens, au fond d’un langage primordial impossible à disséquer.
Je me surprends à les imaginer, à les appliquer de tête sur la plaine et ses collines, de mémoire, de souvenir. Un or vibrant pour les blés, au contraire d’un jaune sec et cassant. Les herbes, un vert intense, piqueté de blanc et de rouge, des couronnes de pétales puissantes. Un azur léger, voilé des blancs légèrement rosés. J’imagine un matin, un monde à la paupière tout juste soulevée.
15 janvier 2026
063. Plaine près d'Auvers
La morosité suinte du papier peint taché. Elle le décolle ; elle forme des bulles le long des murs où s’étend la moisissure. La morosité, c’est l’humidité des états d’âme. Après ma pénible journée, j’ai l’esprit particulièrement humide. Je voudrais le sécher, l’adoucir à grand tour de tambour. À défaut, je le frictionne à la serviette rêche, je frotte le moindre recoin, le moindre pli où l’eau se glisse. Un esprit sec dans un corps faible, voilà déjà une partie gagnée. Mon humeur s’adoucit, la toile au fond brille, cligne de ses larges paupières anguleuses. Une belle respiration m’attend et la promesse d’une éphémère maîtrise du Temps.
Une plaine agricole typique : des carrés colorés et cultivés à la sueur populaire, des lopins laissés en jachère où la Petite Nature s’ébroue d’herbes hautes et de fleurs sauvages, de rares pelotons d’arbres crénèlent les frontières céréalières. Trop peu. La Petite Nature se bagarre la précieuse ombre qu’offrent les ramures. Quand viendra l’été, il faudra se réfugier sous terre, là où grouille l’humidité et le ver.
Le ciel moutonne paisiblement. Ici et là, les cotons célestes s'agglutinent, leur blanc mutin, taquin, sans promesse de pluie. La menace n’est pas à l’ordre du jour. Ils bataillent trop avec le vent pour l’envisager. Éole, lui, s’amuse plus que jamais. Il donne le tempo de la plaine, transporte les fragrances, les murmures et les peines lointaines. Il me chatouille les oreilles, agite les pans de ma cape, me caresse les joues avec amour. Il sait que je viens de loin, d’un monde où règne un lointain cousin. Le vent reconnaît les voyageurs, les salue toujours au seuil des mondes, à la croisée des chemins.
14 janvier 2026
062. Champ aux meules de blé
Ici, le monde continue de s’affadir. Les couleurs refusent d’offrir leur profondeur ou bien notre œil s’aveugle. Tout se mêle en une sinistre boue de marrons et de gris. Le bruit et la fureur abîment les teintes les plus anciennes ; ils souillent nos émotions, jusqu’aux plus intimes ; ils cristallisent un nouveau genre de peur à l’orée du cœur. Pour lutter, je poursuis mes péripéties, je continue l’errance interminable à travers les toiles. Je sais bien qu’elle se conclura un jour, par manque de temps, par ignorance ou bien par faiblesse. Mais si ma volonté demeure, je doute que le tableau ne me fasse jamais défaut.
Aujourd’hui, des chaumières à l’allure de meules ou bien l’inverse. Malgré la prééminence des amas, l’or verdit sur les bords, comme un métal gagné par la vie. Une pairie, plus qu’un champ, longe la gauche du tableau et encercle nos monticules. Des hautes herbes riches, piquetées de fleurs, de tiges de toutes sortes, du végétal cosmopolite où les pucerons ne s’embêtent certainement pas à faire le tri. Sous tous les brins, taille, odeur, couleur, il est de bon ton de déclarer : “voici mon abri”.
Le ciel apaise. Il s’étend en longs traits, miroirs de cirrus diffus à perte de vue. L’azur se recouvre d’une fine pellicule, un brouillard, un voile humide le temps de la toilette. La voûte est coquette, elle se prépare à porter son bleu le plus chaud pour tenir une belle promesse d’été.
Autour de moi, la Petite Nature s’égaille. Les insectes, les oiseaux et le murmure du vent dans les ramures. Tout ce beau petit monde rappelle aux grands mammifères bipèdes que le modeste et le discret habitent depuis fort longtemps le domaine.
13 janvier 2026
061. Champ de blé sous des nuages d'orage
L’horloge mondiale sonne l’avènement de la semaine nouvelle. La grande aiguille crisse douloureusement du dimanche au lundi. La sentence impitoyable sonne. Des matines laïques à l’écho capitaliste. Le réveil tonne sur ma table de chevet. Son fracas m’arrache au plus beau des pays, celui où les couleurs résonnent des mélodies de la vraie vie. La chandelle allumée, j’éteins cet excité, le regard noir, accusateur de m’avoir dérobé un dernier instant de paix. Sur un coup de tête, je me lève, déterminé à fuir cette journée, ce nouveau cycle, cet état de prisonnier. Je fonce au bout du couloir. Le tableau journalier me ravit. Sans attendre, sans respiration, je plonge.
La lumière côtoie les ténèbres. Ils sont voisins et les couleurs le célèbrent. Les blés débordent de vivacité. Leur tendresse promet que leur tige caresse le ciel. Ici et là des fleurs printanières égaient leurs pavés trop carrés, trop anguleux, trop rangés. Déjà en ce temps, les champs ont la fâcheuse tendance à ressembler à un peloton d’armée.
Là-haut, la menace moutonne. Des nuages blancs et cléments persistent, mais au-dessus de l’horizon menace une marée sombre. La nuit s’invite en plein jour et ce n’est pas un jour d’éclipse. Au loin, j’entends le roulement céleste et j’aperçois le furtif nacre des éclairs. Les éléments se mettent en ordre de bataille. Bientôt, la tempête tourmentera les blés de ce côté-ci de la vallée. Le vent s’en fait le message. Il siffle fort, par à coup, tente de me pousser de l’autre côté, m’invite à rentrer pour m’abriter. Je refuse naturellement. J’attends l’orage de pied ferme. Je ressens dans le creux de mes os pulser un désir primitif, celui de se sentir les mains de la Terre palper chacune de mes fibres.
12 janvier 2026
060. Paysage d'Auvers sous la pluie
Les cordes claquent contre le sol. Des oiseaux noirs s'envolent. Le bleu et les gris conquièrent le ciel, le village et les touches de forêt. Seuls les blés résistent ; l'or poursuit cet interminable duel. Le vent siffle plus qu'il ne souffle. L'humidité fait la gadoue. Quelques chapeaux courent se mettre à l'abri, surpris par ce rideau tombé du ciel. Il faut dire qu'il est arrivé vite. Avant l'évènement, au matin, le soleil promettait la chaleur et l'azur de l'été jusqu'au terme de la journée. Finalement, l'averse remporte la partie, avec l'appui une armada gorgée de pluie.
Je me tiens immobile à la croisée des chemins, planté entre les champs, voisin des blés dorés. La visière de ma casquette m'épargne une vue brouillée. Mon manteau me protège des éléments. Le regard rivé vers le ciel, j'attends patiemment la danse des éclairs. Je sens la goutte me pendre au nez. Je tire un mouchoir de ma poche et sonne ma trompette nasale d'une expiration nette. Du haut du champ, je domine le village enraciné en contrebas. Je ne vois rien d'autre que des toits, des cyprès et des blés sur le versant d'à côté.
Je découvre quelque chose d'apaisant dans cette tourmente. La régularité de la pluie. Son harmonie statistique. Le claquement des cordes à la fréquence du vent. À bien y regarder, le bleu décline en violet. La nuit babille ses premières intentions, la volonté de grisonner et d'assombrir. Bientôt, même l'or des blés sera dévoré.
11 janvier 2026
059. Les Vaches
Le troupeau s'épanouit sous le soleil levant. Le ciel scintille. L'or et l'azur se mêlent en incertitude. Un oiseau s'envole, s'égaille du jour à peine levé et appelle le vivant à ouvrir ses paupières. La faim a déjà tiré le troupeau de la torpeur, leur gardien aussi et son chien. Je l'entends aboyé au loin. Le visage des vaches se cache, tourné vers leur destination, un morceau de pré bien vert, garni d'une herbe haute et fraîche. Les marrons tourbillonnent sur leur cuir tendre. Ce dernier épouse leur corps étrange, tantôt charnu, tantôt grêle. Les ondulations offrent une mystérieuse vision de ce que cet animal était.
Je m'attarde peu. Je laisse le troupeau à ses ambitions nutritives. Je me détourne. Je prends la tangente, les yeux fixés sur l'horizon qui barre le pré. Le jaune tranche le vert d'une ligne nette. Dans quelques heures, l'azur engloutira le jaune. D'abord clair, le bleu sombrera dans une nuit noire piquetée d'espoirs.
10 janvier 2026
058. Bords de l’Oise à Auvers
Le bruit et la fureur claquent contre les volets fermés de mon appartement. Jour et nuit, le monde extérieur hurle sa folie sur toutes les ondes disponibles. La stupeur accouche de l'inertie. On reste cloué au lit, le cerne épais, la paupière lourde et l'avenir défait. Mais toujours un peu d'espoir brille au bout du couloir. Le tableau résonne de sa douce note, un accord même, une harmonie claire.
Aujourd'hui, le Maître m'embarque sur les rives d'une rivière, une oie avec un « s ». J'imagine hors champ les guinguettes, les airs guillerets, les badauds, les promeneurs bras dessus, bras dessous. Les plus aisés s'aventurent sur les eaux, une coque imperméable pour tout habitacle. L'audace réussie autant aux hommes qu'aux femmes.
Un incendie végétal dévore la berge et la toile. Ces feuilles épaisses s'expriment en traits resserrés, mais désordonnés, avec l'expression d'un naturel troublé. Les verts se déclinent en multiples visages, des plus clairs au plus profonds. On y retrouve chacune des quatre saisons. Un morceau de ciel s'accroche encore en haut à gauche du tableau. Un bleu plein de vert, un vert plein de bleu. Dans ce carré, les couleurs accouchent d'autres couleurs et l'air est frais.
Je m'assieds au bord de l'eau. Je contemple le courant descendre rejoindre sa vallée. Je guette la Petite Nature animer la surface, les petites ondes et les clapotis insaisissables. Je ferme les yeux et écoute la douce symphonie d'un éclat de paix entre l'environnement et son habitant.
09 janvier 2026
057. Le bosquet
Je retourne sur mes pas, ceux de la veille. À courir comme un dératé pour atteindre les champs, j'en ai raté le bosquet. Ici, les jeunes arbres s'étirent et libèrent leurs fragrances. Leur tronc, fin et solide, grincent gentiment sous la houlette du vent. Les feuillages murmurent les secrets de Dame Nature. Les fleurs charment et aromatisent le vent.
Le bosquet s'étire haut, jusqu'au sommet de la toile. Les ramures se confondent avec un verre vitrifié, où les bulles d'air emprisonnées distordent la réalité. L'orée d'un bois, une porte gardant un secret. Parmi le vert réside un puissant silence, une voix ancienne qui n'a pas encore prononcé sa sentence.
08 janvier 2026
056. Champs de blé avec gerbes
Dehors, les cendres pleuvent, les panaches noirs tourbillonnent vers les hauteurs, paresseusement, grappes mûres de l'incendie rassasié. Tout autour s'agitent les vautours. Leur cou gras frémit à l'idée de dépecer les restes cuits. De ma fenêtre, je contemple cette interminable fin, impuissant, les sens saturés des quatre coins de cet enfer grandissant. Le feu rugit, nourri au souffle de l'Oncle maudit. La Bête a faim. Je ne suis qu'un homme. Je marche sous le ciel, rien de plus. Seuls les oiseaux volent.
Aujourd'hui, les champs de blé offrent un refuge inespéré. Une goutte paisible dans l'océan trouble de la réalité. Une vague modeste, barrée d'un léger trait d'écume, une douce émulsion iodée. Ce n'est pas la mer que je vois là, mais bien un parfait ciel d'été. Les blés s'effondrent au rythme de la sueur perlée et du fer aiguisé. Je déchante. L'évasion, l'illusion, tout se brise à ce son. La pensée s'infiltre. La fissure béante de l'esprit l'y aide, trace un chemin direct et frappe au cœur.
La mélancolie m'envahit. Je scrute le ciel, l'œil humide, le cristallin trop clair ; presque en moi la volonté d'être aveugle. Je cherche le soleil pour en finir. Finalement, je me résigne et je souris. Ce joyeux ciel porte une bien belle moustache en guise de nuage.
07 janvier 2026
055. Jardin à Auvers
Au jardin d'Auvers s'écoulent les pétales printaniers. Du pointiller au trait, le blanc s'étire et forme une ronde, danse autour des parterres fleuris, bénis sous le soleil de midi. Le ciel tourbillonne, vert forêt, vert d'eau, vert sève. Les nuances s'enroulent, se mêlent et se confondent. Elles accouchent de couleurs nouvelles, inconnues au bataillon des longueurs d'onde. À mes pieds, le chemin ressemble à une plage à marée basse. Le gris des galets reflète la lumière solaire, se prend pour une flaque d'eau, un drôle miroir d'ambitions. En décalage, enraciné, un puits, un petit puits vient achever la perfection de cette oasis. Les humeurs encore pleines de miasmes, je racle un peu et ravale ma mauvaise substance. Je ferme les yeux et inspire autant que possible. L'odeur du printemps m'apaise. Mes muscles se détendent. Hors champ, je m'assois sur un banc. Là, l'esprit ballant, je laisse les oiseaux me bercer de leur chant.
06 janvier 2026
054. L'Enfant à l'orange
La même bouille fantasque. Les mêmes solaires sur les joues. Une orange en guise de balle. Un cadeau. Un présent à déguster sagement. Une robe bleue, une mélancolie enfantine qui perle sur les plis. Autour les jaunes ondulent sous la caresse des vents. Moi, loin au fond de mon lit, dans le froid sombre et glacé de mon appartement, je tousse. J'envie l'enfant à l'orange. Je patiente. Bientôt la santé répondra présente.
05 janvier 2026
053. La petite arlésienne
La pluie claque contre la vitre. Les gouttes dégoulinent le long du verre. L'impact laisse son empreinte, un rond moussu, donnant l'air d'un papier peint à pois. Il pleut ailleurs ; dans ce regard triste, noir d'une mélancolie profonde ; sur ce haut de robe, les larmes s'écoulent en longs traits, une autre pluie, d'autres pleures. L'ocre fauve du tissu n'y change rien. Son feu ne rattrape rien. L'émotion s'échappe, fuse et pique le cœur au malheur. Le visage fermé, le teint maladif, jauni par le souci. Une terrible nouvelle est arrivée aujourd'hui.
04 janvier 2026
052. Jeune Fille en blanc
L'inspiration m'échappe. Elle s'enferme dans une cage, loin à l'abri de la fièvre. Tant que le mal ne retombera pas, les mots se coinceront quelque part entre ma gorge et mes poumons. Mais aujourd'hui, une certaine énergie m'anime. Je remonte la pente lentement, à coup de petite redescente partielle, mais dans l'ensemble ma santé retrouve des couleurs. Alors, j'en profite, je me traîne au fond du couloir. J'ignore le reste. La vaisselle attend dans l'évier. La fenêtre est en battant. Les miettes traîne sur la table à déjeuner. Les peluches de poussière somnolent au coin des murs. Je rampe et me relève, le genou fébrile. Je plonge. L'apnée me cueille. Je voudrais tousser. Cracher mes poumons tout d'un coup. Cette seconde précise, cette transition d'un monde à l'autre me l'interdit.
Je touche terre, champ et blé. Mes yeux se remplissent de vert, de jaune, de rouge et de l'énergie vibrante des blés. L'inconnue en blanc, escortée de coquelicots aux promesses narcotiques, se dresse, elle aussi, fébrile. Autour de sa fine silhouette, danse des signes, des hiéroglyphes végétaux ou bien des formes vides que la main du Maître a oublié. L'inconnue attend au cœur du champ qu'une lassitude l'emporte ou que ces signes vides lui révèlent le secret d'une vie bien remplies.
03 janvier 2026
051. Paysanne au chapeau de paille
Une nouvelle fois, je me défile devant l'exercice. Pas de voyage métaphysique pour moi aujourd'hui. Ma gorge racle tout ce qu'elle peut. Elle remonte les miasmes des tréfonds de mes bronches. Une lassitude chronique m'empêche de payer mes lettres quotidiennes, correctement du moins. Enroulé dans mes draps humides, l'œil torve, le front luisant, je guette malgré tout la toile. La femme au chapeau s'agenouille à mon chevet. Le visiteur visité. Quelle drôle de magie opère ? Son regard noir se soucie de mon état. La compassion se peint peut-être sur ses traits, sur ce visage buriné par un soleil d'été. Sa robe à pois ondule. Des courants marins y circulent, comme autant de serpents entre les champs. Je les entends siffler, chanter un hommage dans leur étrange langue. La fièvre me transcrit les paroles.
« Petit homme, dors. »
02 janvier 2026
050. Deux fillettes
La fièvre me brûle encore le front. Le drap colle à ma peau moite et salée. Ma sueur sent l'acide et les humeurs maladives. La tête de lit sous la fenêtre, les rideaux de laine tirés, aucun soleil ne perce à travers le verre. Il s'infiltre seulement par les contours dénudés, imprégnant de fins liserés sur le plancher. Les lattes gémissent sous la chaleur de ces rayons inespérés.
Roulé en boule sur mon matelas enfoncé en « v », mon œil fixe le bout du couloir. Plongée dans les ténèbres, la toile brille comme la sortie d'un tunnel. J'y devine le même tableau qu'hier, une variation tout au plus. Je renifle bruyamment. Je renâcle. Je tousse. J'expulse des miasmes à m'en récurer les alvéoles. Aujourd'hui encore, je n'irai pas à la rencontre du Maître. Je lui laisse les marmots à la bouille issue d'un obscur conte, où la morale se destine davantage à l'adulte perdu qu'à l'enfant naïf et nigaud.
01 janvier 2026
049. Deux fillettes
Nous sommes toujours rendus au même point. Peut-être mon état a-t-il même empiré. La fièvre déforme les traits, accentue le grotesque, foudroie les couleurs et leur prête une intensité que le Maître nierait. Le toit des maisons ondule. L'ardoise coiffe le sommet des vagues. Et mon esprit, lent, lent, lent, peine à regagner la surface.
31 décembre 2025
048. Jeune homme au bleuet
La fièvre dessine des visions. Elle s'amuse des images. Elle les fait fondre. Sous son emprise, les formes ondulent. L'air devient une mer par temps calme. La chevelure fauve se détache à peine du ciel ocre. Le visage porte l'empreinte solaire, la claque photonique qui brûle plus qu'elle ne rougit. Un sourire pâle, étiré, fabriqué. Des yeux presque éteints, mortifiés. Le bluet glissé entre les lèvres craquelées, pas encore sec. J'ignore pourquoi, mais cet homme me fait l'effet d'une marionnette.
30 décembre 2025
047. Marguerite Gachet au piano
Les doigts courent sur le clavier, frappent les touches en triolet. Avachi au fond d'un canapé bourgeois, je sirote une liqueur épaisse, un sirop médicalement peu recommandé. La fatigue s'ajoute à l'ivresse, mes pensées tourbillonnent sans que je ne puisse les arrêter. L'alcool brûle mes lèvres sèches. Il foudroie aussi mes sens. Au-dessus de ma tête, je devine la musique danser, les noires, les blanches, les croches tournoient. Je ferme les paupières. Encore, je les vois.
29 décembre 2025
046. Vase avec des fleurs
Il pleut. Les cordes claquent contre la vitre derrière le vase. Le ciel pleure des âmes inconnues parties au cœur de la nuit. Le chagrin du ciel lorgne sur la frénésie. Des « tac tac tac » continus, sans cadence, sur le temps. Les larmes célestes dégoulinent en torrent sur le verre. Pleines de poussière, elles laissent leur empreinte, témoignent de leur passage avant de rejoindre la terre, ses racines et ses vers.
Aujourd'hui, les lignes portent les pétales. Elles les maintiennent à hauteur de regard, comme des coupelles défiant la gravité. Les couleurs seules y ont droit. Les autres, les fleurs de moindre importance, les anonymes aux pétales blancs, s'élèvent d'elles-mêmes. Légères, aériennes, elles rappellent les nuages avant qu'ils ne se gorgent de pluie et déversent leur chargement sans prévenir.
Je me retourne, dos au vase, le regard vers mon départ. Le temps me manque pour m'attarder. J'avance avec le souvenir d'une couleur, d'une humeur : un vase triste, mélancolique, privé de la chaleur des ocres fauves. Une pointe de rouge a été cueillie. Elle rougeoie certes, mais elle s'éteindra avant que ne tombe la dernière perle céleste.
28 décembre 2025
045. Roses et anémones
Cette fois, le bouquet de couleurs se substitue au bouquet de fleurs. L'intensité du fond l'emporte sur la frilosité de la forme. Le même sujet, presque. Un vase transparent, vert d'eau, un paquet de racines qui s'entremêlent dans un verre d'eau. Il y a du monde. Ça joue des coudes et des feuilles. Certaines malheureuses se retrouvent sur le bas-côté, la tige penchée, le poids des pétales lourds de la gravité. Les roses s'écartent des anémones, fuient au risque de tomber. Dans leur vanité, elles préfèrent raccourcir l'éphémère que de se confondre à des moindres de beauté. Un orgueil somme toute banal.
Aujourd'hui, la table, carrée, se distingue du mur de plus d'un trait. Leurs couleurs se repoussent d'un contraste léger. Un bois intense et brillant pour le meuble, un gris nuageux chargé par l'hiver pour la bâtisse. Une abstraction moindre. Un pas de plus dans le réel. J'effleure du bout des doigts les pétales de roses. Je ressens leur fragilité sur ma pulpe charnue. Si je n'y prends pas garde, mes ongles mal taillés pourraient les mutiler.
Je m'assois à la table, face au vase, face aux roses patriciennes étouffées de l'existence de la plèbe. Mon regard se moque d'elles. Mon esprit se moque de moi-même. Les anémones murmurent quelques bêtises. Dans l'attente que le soleil se lève, nous formons cette petite ronde moqueuse et taquine.
27 décembre 2025
044. Vase avec fleurs et des chardons
Un silence hivernal embaume la maison. Dehors, un ciel clair, lavé des nuages de la veille. Le froid règne partout en maître, alors les rares gazouilleurs s'inclinent et se taisent. Blottis dans leur nid, ils attendent le renfort de quelques rayons, l'étendard coloré de la chaleur. Le gel fige une partie de la réalité ; il ralentit le cours des évènements, raccourcit la flèche du Temps. Les gestes s'éternisent. Je peine à ouvrir les yeux, les paupières collées après un sommeil profond, des rêves intenses et la sensation que mes aventures oniriques restent inachevées.
Un nouveau vase. Un nouveau bouquet. De nouveaux brins trop tôt arrachés au jardin. Les couleurs me rappellent une ambiance aquatique. Un vert d'eau tapisse la table et les murs. Une nouvelle fois le mobilier se distingue d'un seul trait, rien de plus, si ce n'est peut-être une légère teinte plus claire, une touche de blanc, un névé d'altitude.
Le vase détonne au milieu de cet hiver pictural. Une couleur chaude. Une poterie bien cuite, une argile profonde qui a connu le tourment de la braise et des fumées charbonnées. Les traits s'enroulent en son centre, pointent vers une singularité invisible en son milieu. Le tout, abstrait, rappelle les motifs stellaires du maître. Voyait-il des étoiles sur l'argile cuite ? Il projetait les beautés célestes sur la basse terre.
Les chardons sont à l'honneur, vibrant de leur couleur. Ce bleu en lisière du violet, une rareté de la Petite Nature, car gourmande en énergie. Rares sont les photons qui s'y essaient. Cela est vrai tant chez le végétal que l'animal. Partout dans la Nature, le bleu s'illustre comme une couleur royale.
26 décembre 2025
043. Verre avec œillets
Un drôle de vase. Un drôle de bouquet. De drôles de fleurs. Penché, le tout s'apprête à s'effondrer. Un coup de vent, un coup de rien et le verre brisé. L'ombre s'improvise en béquille et la lumière tient, se retient à sa sœur de contraste. Le vase se maintient, fier, droit dans l'esprit, penché dans l'allure.
C'est l'aperçu que je devine au fond du couloir. Le tableau brille d'un jaune nectar. Je défais mes lacets. Je change d'avis, j'irai en chaussons. Après tout, le vase, la table, le mur, tout indique une chaleur d'intérieur. Des rayons d'été à travers une vitre. À moins que l'été ne soit pas la saison des œillets.
Une nouvelle fois, j'accomplis le rituel. Une mécanique parfaitement huilée. La parole et les gestes accomplis, la toile frémit. La réalité devient tangible, une fraction de seconde laisse l'espace à un flou artistique. L'espace et le temps échangent leur dimension. Mes paupières se ferment et mes yeux demeurent grand ouverts. Les contraires coexistent. Les états se superposent. Un noir d'encre, puis la lumière du tableau m'éblouit.
Une table minimaliste. Un simple arc de cercle, une ligne d'encre, une épaisseur et rien de plus. Pour le reste du décorum, un jaune, des jaunes, une lumière, des lumières. Un soleil fort, intense, une énergie matinale pleine de promesses dont celle de lutter contre le froid hivernal.
Je m'approche du bouquet, de cette Petite Nature en soin palliatif. Les pétales luttent avec bravoure ; ils continuent d'exprimer l'intensité de leurs couleurs. Mais l'énergie leur manque, les tiges penchent sous le poids du déracinement. La bonne vieille terre est restée libre, dehors, sous la bienveillance des Éléments. Bientôt, la sécheresse gagnera malgré le fond d'eau. Cueillir accélère l'éphémère d'un simple geste, innocent, mais aussi criminel.
25 décembre 2025
042. Sous-bois avec deux figures
Je me cache à l'ombre des feuillages. Je sillonne entre les troncs alignés façon légion. Je les salue d'un discret hochement de tête, deux doigts tenant la visière de ma casquette. Nos regards s'alignent, une connivence s'installe. La Petite Nature me reconnaît, même à travers les frontières du réel. Elle reconnaît les âmes qui tentent de se jouer d'elle et de contourner ses règles. Elle reconnaît la bêtise et l'hubris de mes maîtres. Pour ma part, j'utilise mon pouvoir à la proportion de ma personne. Je ne brise aucune convention que je ne saurai réparer à ma façon.
Je reste spectateur du passé. Je n'interviens pas. Je reste coincé à l'arrière-plan. Je me tais. Je reste un témoin, peut-être lâche qui craint de bousculer les événements. Car je connais l'enchaînement sur le bout des doigts. Je connais la machine infernale qui s'apprête à démarrer. Je connais la fin avant même que l'Histoire n'ait commencé. Cette Histoire-là. Pourtant, Elle se répète. Et cette fois-ci, tout le monde sait. Personne ne pourra arguer de ne rien y connaître. Les livres ouverts à la page 33 relatent la débâcle, les senteurs brunes du lac. Mais je m'égare, alors je ramène mon esprit sous les feuillages, là où les ramures frémissent et murmurent le langage primordial.
L'écorce pleure. Des larmes marines s'écoulent le long des troncs. Les arbres s'émeuvent de la pauvreté des promeneurs. Bien ordonnés, mais abandonnés, ces héritiers d'ancêtres vénérés rêvent d'un culte à la hauteur de leur destinée. Ils se prédisent millénaires, le tronc épais et recouvert de cernes. Ils murmurent du bout des feuilles. Ils tendent leur branche vers leur prochain. Leur contemporain. Leur copain. Un simple humain. Mais personne ne les écoute. Personne, en retour, ne leur tend la main.
Le couple se promène. Il se moque des enracinés et de leur feuillage délavé. Aveugle, il serpente entre les troncs, le rire gras, riche d'un bétail de choix. Les sens clos à l'appel de la Petite Nature, il ne voit pas l'altérité, l'illusion, la cicatrice incarnée par des rangées d'arbres bien trop alignées.
24 décembre 2025
041. Paysage au crépuscule
La journée touche à sa fin. Le soleil déploie ses apparats les plus flamboyants. Le ciel s'embrase jusqu'au firmament. La chaleur torride de l'été pèse encore en cette heure tardive. La sueur colle les vêtements à ma peau. Voilà une courte éternité que je randonne le long des sentiers. Je respire avec la profondeur de l'effort. Je m'arrête un moment, conscient d'avoir retrouvé le cadre de la toile. Les arbres n'y trompent pas. Je pourrai m'attarder sur les champs, certainement des blés, sur le village dont les toitures s'extraient de la forêt, mais le ciel garde mes yeux en captivité.
Si l'amalgame avec la flamme est facile, je lui trouve aussi un air de blé mûr, un reflet des champs désordonnés, couchés par quelque vent. Les traits plats, légèrement ondulants, les tiges se relèvent fières ; la toile en a figé le mouvement. Ou bien une mer d'ambre, une eau claire et pure, transparente faisant la part belle à un sable aux grains inconnus. Les traits renvoient au mouvement, à la dynamique des courants, des bancs de poissons qui toujours plus profondément s'enfoncent. Sous cet ocre liquide, les abysses prennent des allures de salle au trésor.
Quelques oiseaux chantent un dernier refrain du haut de leur nid. Plus aucun n'a la volonté d'en sortir. Le sommeil a gagné. Les ombres volantes, furtives et rapides, se font chauve-souris et chouette pour les éclairs au plumage blanc. Le clocher sonne la demi-heure au loin. L'heure du dîner approche. Je me remets en route, le pas affamé après une interminable journée.
23 décembre 2025
040. La Plaine d'Auvers
Le cycle hebdomadaire se renouvelle. Le festival de l'hiver raccourcit cette nouvelle boucle annonçant la clôture prochaine de la révolution Terrestre. Un matin calme et clair. Une nuit encore profonde, alors je me mets en quête de lumière. Les paupières collantes de sommeil, je prends le chemin habituel, guidé par l'automatisme naissant. Je ne m'arrête pas devant le tableau. Je ne souhaite pas connaître à l'avance les détails. Aujourd'hui, j'ai attrait pour la surprise. Pourvu seulement qu'il ne s'agisse pas d'un nouveau portrait et que le fantôme d'hier ait enfin trouvé la paix.
Un paysage. Des champs dessinés à l'équerre. Des lignes droites, bien définies, les déterminent. La main verte de la région est aussi une main sûre, assurée plutôt, savante, connaisseuse de son métier et de son labeur. Les champs s'étendent à perte de vue, dans un mélange de variété et de couleurs : ici des blés d'or, là des espèces vertes, de jeunes pousses que je ne reconnais pas de ma hauteur.
Malgré l'inclinaison, le léger dénivelé, la colline m'apparaît plate, dépourvue d'aspérité. Un monticule lisse, érodé par le vent depuis bien longtemps. Seuls quelques arbres s'arrachent de terre, montent au ciel et défient la monotonie du relief. Leurs feuillages ondulent et leur couleur sombre les apparente à la fumée d'un joyeux foyer.
Le ciel se pare d'une robe étrange, un verre bouteille dont je guette la marée prochaine. Je peine à en comprendre la nature. Chaque recoin céleste se compose de cette pâte opaque qui filtre la lumière stellaire. Les traits dessinent les vagues, le courant, l'animation joyeuse d'un lagon. Ce dernier mot m'évoque l'anachronisme. Mais qu'importe, après tout, je voyage de toile en toile, je me berce de couleurs et de traits auxquels je ne comprends goutte, alors qu'importe l'existence d'un lagon dans le ciel d'un peintre qui n'en contempla jamais. Sa confusion entre ciel et mer m'émerveille.
22 décembre 2025
039. Portrait d'Adeline Ravoux
Je devance le soleil d'un rien. Ma paupière s'ouvre juste avant qu'il ne déborde de l'horizon. La nuit règne encore, mais son voile s'éclaircit à l'Est ; à moins qu'il ne s'agisse d'une ville. Je me lève sans faiblesse, le pied sûr, bien arrimé au plancher. Les lattes s'étirent, leurs fibres se dilatent sous l'action du chauffage. L'eau glougloute dans la tuyauterie cuivrée de la maison. Un peu d'air s'y trouve encore prisonnier. J'échoue à l'en libérer. À croire qu'il ne souhaite pas regagner l'entièreté de ses droits. Une petite faim matinale me travaille le ventre. J'engloutis une ou deux bouchées au hasard avant de rejoindre une troisième fois cette inconnue qui joue la muse.
J'ignore qui de nous deux est le fantôme. Aujourd'hui, tout particulièrement, je lui trouve le maintien et l'aura spectrale. La toile renvoie un reflet d'âme plutôt qu'une image charnelle. Je jurerai son corps intangible, déstructuré, immatériel ; simplement visible à l'œil volontaire, mais étranger au toucher. Un corps qui se traverse, contre lequel on ne peut buter, un fantôme, un spectre, une âme perdue : une âme trop tôt partie errer en quête d'un vain paradis.
Mon sentiment tient aux couleurs, évidemment. Ce bleu. Ce bleu pas si bleu. Ce bleu riche d'autres pigments, discrets, un rien de jaune ou de vert ajoutant une sorte de pâleur à leur couleur mère. Le nœud, le col, le foulard, les manchettes, des pièces d'un blanc aériens évoquant une dentelle légère frémissant sous le vent. Et derrière, les ténèbres, un empire auquel l'âme de cette innocente ne peut s'arracher. Ses bleus s'y embourbent, comme dans des sables mouvants.
Le visage stoïque, l'expression indifférente au sort qui l'attend, son regard porte au loin, légèrement incliné, rêve peut-être de l'ici-bas, de redescendre parmi les vivants. Les bleus se déploient autour d'elle et donne corps à son aura. La jeune femme m'apparaît, soudain, magicienne, maîtresse du feu azuré, capable de crépiter au fond de la mer. Je souris, un léger trait incliné au coin de mes lèvres sèches. Je reconnais en elle quelqu'une de mon peuple, une âme affiliée aux Arcanes. Qui sait ? Peut-être visite-t-elle des toiles du futur pendant que je garnis l'esprit du passé.
Je décide de m'en aller, de retourner au vieil appartement où la réalité de mon Temps m'attend. Au dernier regard, mon cœur décroche. L'inconnue me fixe et me sourit. Une véritable magicienne d'une lointaine époque.
21 décembre 2025
038. Portrait d'Adeline Ravoux
Hier était un jour chômé. J'ai délaissé la toile pour me prélasser, reposer l'âme et le corps de l'errance quotidienne. Après la libération des horloges, j'ai vaqué aux occupations ordonnées par le quotidien. La toile n'intervient qu'après le nécessaire, alors si celui-ci n'est pas fait, la priorité lui revient. Le Temps seul arbitre l'organisation de la journée. Ça s'embouteillait hier. La toile est restée coincée à l'idée de projet. Je dois rattraper cet écart, revenir à la tradition qui nourrit ma créativité.
Ma chaise grince contre le parquet ciré. Les pieds creusent légèrement leur sillons dans les lattes. La promesse d'un portrait, alors je ne m'embarrasse pas de tout l'attirail. Je m'apprête à peine. Une vieille casquette pour coiffer mon crâne. Rien de plus ne s'accorde à mon chandail délavé et mon vieux froc rapiécé. Je m'enfonce dans le couloir dont le bout rayonne d'une promesse d'aventure et de rencontres incongrues. L'adolescente patiente au cœur des ténèbres. D'elle jaillit la lumière d'un soleil.
Un bien curieux portrait que celui-ci. L'ombre habille le fond, parsemé de bleu ici et là, comme l'étendue d'un lac coincé au fond d'une étroite vallée. Les quelques verts m'évoquent des plantes aux racines aquatiques, des mousses et des lichens humides. J'entends des moustiques s'activer autour de cette mare. La nuit règne et les lampes à pétrole défrayent la chronique chez la masse insectoïde.
J'ignore quoi dire de Madame. Son regard exprime une émotion qui m'échappe. Une stupeur mêlée d'ennui, l'air de se dire : « Que fais-je ici ? ». Une morosité, une mélancolie, une lame perfide déjà pointée sur le cœur, là, à l'intérieur, là où palpitent les chairs et se régénère le sang de nos veines.
J'abandonne Madame. Sans un mot. Je joue mon rôle de fantôme. Je m'enfonce dans les ombres et les eaux. Le froid me remonte à la cime de l'échine. Je frissonne. Des spasmes me secouent. Puis, je plonge sous les eaux, une main tenant fermement ma casquette. Un portail comme un autre. Mes paupières se referment sur les ténèbres. Et d'une pensée, d'un claquement sec, l'eau vibre, une lumière passe et me revoilà trempée de la tête aux pieds sur le parquet de ma réalité.
20 décembre 2025
037. Portrait d'Adeline Ravoux
Navrée madame du portrait, mais ce matin, je me trouve particulièrement pressé. Je n’ai guère le temps de m’attarder sur les détails de vos traits, de vos couleurs et de vos bleus. L’horloge me pousse. Un tic tac frénétique me rebat les oreilles. Il menace à tout moment de son coucou. Bientôt sonne l’heure de l’usine, sauf que l’usine n’est plus et en lieu et place se tient un bureau sous néon et un duo/chaise bureau sous un faux plafond.
Mais les bleus m’intriguent, alors je tarde malgré tout. Je renonce à l’urgence, y regarde plus près. Ils ont la profondeur de la mer ; le liseré d’écume sur la crête des vagues, le mouvement du courant. Madame vous baignez dans de belles eaux, bien qu’une mélancolie vous enveloppe toute entière, un véritable rideau de chagrin, le ressac permanent dans une baie où s'épanouit un grand vent.
La peau et le bois font office de lumières. Ils jouent la source à la place du soleil. Mais la couleur, peut-être sous l’influence du contraste, porte une maladie. Le jaune se fait cireux, plus que lumière. Il porte en lui une forme d’hésitation et de faiblesse.
Le regard aussi complète cette idée du portrait. Pauvre dame mal à l’aise de jouer à la muse. Sans doute, craint-elle le feu de l'œil qui la sculpte en couleurs.
18 décembre 2025
036. Épis de blé
Nouveau réveil matinal. Le soleil tarde à émerger dans le duché d’Aquitaine. L’astre sommeille sous l’horizon, ses paupières lourdes de protons. L’organique plus vaillant que le stellaire, mais le petit être demeure bien éphémère. Le néon de la cuisine se stabilise. Il clignote à une fréquence constante, cadrée, prédictive. La table est propre, nette, pas une tâche ne menace de jaunir son plastique. Il n’y a guère que le temps, l’entropie et la dégradation moléculaire pour encore tenir cette mauvaise promesse. Je secoue la tête, je m’ébroue façon cheval, le visage encore humide de la toilette matinale. J’enfile ma parka, j’ignore où la toile me destine. Dans cet exercice, l’adage se trompe. C’est bien la destination qui compte, car le voyage ne dure qu’une fraction de seconde.
J'atterris plein d'allégresse, le pied léger, la tête sereine. La journée n’a pas encore eu le temps de me saturer les sens. J’ouvre mes œillères, réceptif, une antenne toute neuve qui capte toutes les fréquences possibles. Un blé jeune, vert, désordonné, faussement, car si je lève le regard, je découvre un champ parfaitement carré.
Le vert domine. La jeunesse domine. La promesse d’un avenir doré, riche et plein de beauté. Mais aussi une vieillesse sèche, craquelée, le grain prêt à être consommé. Un recyclage de la denrée, en farine, broyée, tamisée, mise en sac pour rejoindre la guilde des pâtes levées. Le blé, vert de la racine à l'épie, ignore son destin. Lui pousse naïvement dans son champ, entouré de ses proches, des copains avec qui on rompt le pain selon l'étymologie.
Si le vert règne en maître, une palette en mille nuances et pour certaines légères, un jaune et un rouge furtifs s’invitent à la fête, des traits fins et discrets ici et là permettent de briser une perfection colorée, un tout trop homogène. Ils marquent la dissonance du réel dans la vision du Maître.
Debout au milieu du champ, je dépasse d’un bon mètre le plus haut des épis. Ma silhouette de grand dadais se repère à mille lieues. Personne autour de moi, ce champ immense, interminable et pas l’ombre d’un village, d’une masure, rien d’autre qui ne souhaite remplir le cadre. Je reste planté là, pantois, attendant qu’un événement survienne, que l’inconnu me surprenne. Peut-être verrai-je les blés dorer au soleil, se raidir de la racine à l’épie, refouler le vent et ses jeux d’enfants. Oui, je verrai les blés s’oublier sous la torpeur de l’été, ne plus me reconnaître, oublier qui je suis. Bientôt, je verrai les blés mourir.
17 décembre 2025
035. Verre de fleurs sauvages
Réveil matinal, je prends la journée de vitesse. Debout avant le lever du royal. La nuit étend sa toile, les étoiles scintillent de toutes les couleurs à l’exception du vert. Les points blancs apparaissent ronds alors qu'en vérité, ils se taillent en croissants. Les planètes, les sœurs voyageuses de notre Terre. La lumière provient d’une modeste lanterne, la flamme électrique fatiguée, d’un jaune orangé. Elle palpite au rythme d’une tension vieillissante. Les électrons bouchonnent au tournant du cuivre oxydé. Bientôt, l’intensité faiblira au point de céder l’espace à la nuit tardive.
Nus pieds, le pyjama pour simple appareil, je rejoins ma quotidienne. Je l’embrasse du bout des lèvres. La surface ondule, comme après la chute d’une pierre dans une eau tranquille. Un trouble s’installe. Le flou gagne. Les contours s’effacent. Le temps d’un instant. L’instant crucial où je franchis le portail, où le fantastique se mêle à l’esprit, où le rêve cesse de culminer à l’onirique.
Un vase. Encore un. Plus modeste certes, car je découvre devant moi un verre. Le bouquet lui aussi se montre plus humble, tant dans sa composition que dans sa floraison. Nul incendie aux pétales pavots ne racine dans l’eau. Un vert sauvage sur le point de jaunir le remplace, des fleurs sauvages qui me rappellent la liberté des espaces de Provence. Au fond du cône de silice durcie, les tiges s’emmêlent en un tourbillon racinaire. Elles boivent tout leur saoul l’eau froide et claire, l’offrande généreuse d’une main supposée verte.
Derrière l’apprenti vase, le mur se peint de traits bleus et pâles. Un jaune pastel tente de s’inviter à la fête, de conquérir pan par pan le territoire du simili de l’azur céleste. Mais c’est avec peine. Cet or fatigué ne prolonge que la petite table où reposent nos fleurs arrachées. Il les prolonge en quelque sorte ; leur confère une sorte d’aura, un apparat mystique comme un vieux chapeau pointu destiné à recouvrir un crâne dégarni.
En haut, une tache rouge vibrant. Un reste de la veille. Des pétales oubliés et téméraires. Ou bien, un papillon, autre avatar de l’éphémère qui prit d’une folie sur le seuil, butine une nature morte.
16 décembre 2025
034. Coquelicot et Marguerite
La journée s’étire, elle n’en finit pas d'égrener ses heures interminables. Les minutes confinent à l’éternité. Malgré la course solaire, je doute qu’adviennent le sommeil et la nuit. Une fatigue me poche les yeux, mais l’esprit refuse la veille. Je fixe le tableau, assis sur mon tabouret haut, les jambes se balançant légèrement. Le dos courbé, l’échine ronde, les épaules en plomb, je redresse le regard pour accrocher les sœurs couleurs. Une longue respiration, puis je plonge, la pupille dilatée, comme soumis à la fulgurance d’un narcotique.
Une légère déception. Un nouveau bouquet. Encore un. Et si je connais bien mon peintre, il en existe encore une petite ribambelle à visiter. Celui-ci rugit et dégueule de terribles couleurs, un rouge envoûtant, un rouge pavot, un rouge saluant l’élégance du sang. Mais l’intensité d’une couleur n’existe que dans le contraste d’une complémentaire, ici j’ai nommée le vert. Plus subtil, lui choisit de se dégrader en une infinité de nuances, du clair jusqu’au rare foncé. Une teinte de forêt se tapit à l’abri des tiges, couvertes des murmures et des glougloutements des déracinées au brin pâteux.
Les marguerites tentent de jouer le jeu, de concurrencer les coquelicots, de s’approprier la titulature du bouquet. Vanité vaine. Mais, une âme charitable a salué l’effort. Je ne l’aurais pas fait. Le bleu nuit à l’arrière méritait bien plus de se trouver en tête d’affiche, d’être promu au rang de personnage principal de cette histoire de vase.
Je m’accoude à la table, l’air mi-niais, mi-bête. Je me perds dans les rouges. Je me demande si je puis y plonger comme je plonge dans les toiles du Maître. Qu’y verrai-je, au cœur des pavots ? Sans doute serai-je pris de vertige devant la profondeur des rêves inspirés sous l'emprise narcotique.
15 décembre 2025
033. La Maison blanche, la nuit
Un air de musique anime la nuit. Une petite mélodie guillerette, modeste, de quoi amuser et tirer le sourire au coin des lèvres. Sous les lustres flamboyants et dorés, les convives festoient avec allégresse, les papilles saturées de saveur, les lèvres grasses. Ça crie et rit d'un bout à l'autre de la longue table. Les regards se croisent, pétillent et se vitrifient sous la torpeur des spiritueux translucides. Les belles tenues sont de sortie. Chacune et chacun s'est mis sur son trente-et-un. Une fête de mariage peut-être. Une communion. Un baptême. Un sacrement ou bien une débauche d'hérétique de l'aveu du pasteur du coin. Sans doute rien de tout ça. Rien qu'une fête comme il en existe tant d'autres ailleurs à cet instant précis.
Les convives vont et viennent dans la maison blanche. Bien apprêtés, les invités gloussent à l'entrée. Ils se chamaillent gentiment, s'accusent d'avoir un verre de trop dans le nez. Les cyprès gardent le chemin de ronde des lieux. Vaillants veilleurs, ils prennent leur mission très à cœur. De tailles modestes, ils atteignent avec peine la hauteur du premier étage. Leur cime n'a pas vu sur les tuiles et la pente ocre du toit. Les cheminées se font discrètes. Aucune fumée ne les trahit. Au cœur de l'été, même sous une nuit enlunée, inutile de faire crépiter le bois.
Voyageur de passage, assis sur un banc en face de la maison blanche, je l'observe vivre. Une belle bâtisse. Un lieu de vie et de rencontres entre des gens. Mais quelles gens ? Quelles fortunes et quels pedigrees ? Tout le village est-il convié ou seulement les castes de bonne famille et leurs héritiers ? Entendrais-je un paysan chanter sa vie de labeur au cœur de cette bombance embourgeoisée ?
Sous le kaléidoscope lunaire, le communautarisme classiste s'épanouit en soirée mondaine. Les artistes attendent à la porte. Ils n'ont vu que sur la maison. À défaut d'en fouler le plancher, ils la peignent et figent les mauvaises âmes humaines.
14 décembre 2025
032. Fleurs sauvages et chardons dans un vase
Une matinée brumeuse. Une poix épaisse. Une humidité latente. Des arbres à l'allure de spectres. Des fantômes habillant les paysages à travers nos fenêtres. Les rideaux laineux tirés, la lumière hivernale s'installe dans la cuisine. Le néon clignote, encore fatigué du labeur de la semaine tout juste écoulée. Il gémit sa tension intermittente. Son starter fatigue ; il arrive en bout de course après une décennie de pointage à l'interrupteur. Sur la table, le café fume paisiblement, entre les céréales et les tartines. La brique de lait s'aère, l'opercule ouvert. Une goutte dégouline le long du carton recyclé. Et moi, dans ce tableau petit déjeuner banal, je fixe le véritable tableau au fond du couloir. Un vase. Une Petite Nature arrachée à la terre, déracinée, privée de son éphémère. Je me lève, soudain, pour aller la saluer.
Les chardons me rappellent ceux de la veille. Ce bleu caractéristique. Ce bleu rare que la Petite Nature porte peu, car ces couleurs-là requièrent une énergie folle. Des feuilles immenses, des fleurs blanches, des roses et un bouquet d'or comblent la céramique. La petite table contraste, met en valeur la collection florale, un blanc simple, un blanc fatigué, presque plastifié. Mais au temps du Maître, le plastique n'existait pas. Les raffineries et l'industrie pétrochimique ne se rêvaient pas. La modernité s'annonçait certes, mais personne ne prédisait la mesure de son impact.
Je m'assieds à la table en tirant une chaise. Personne ne m'y a invité, mais personne n'habite la pièce. Je me retrouve devant mon petit déjeuner, mais cette fois-ci c'est un bouquet. Je le regarde intensément, la tête légèrement penchée, la bouche entre-ouverte, l'esprit égaré. Je me perds dans les couleurs et le parfum des fleurs séchées. Presque séchées. Les couleurs transitent. Elles glissent d'une longueur d'onde à l'autre. Les molécules se dégradent ainsi. Les photons changent d'énergie. Et ainsi, l'œil se fait témoin de l'entropie et de l'inéluctable flèche du Temps.
13 décembre 2025
031. Le Jardin de Daubigny
Fin de semaine. Je dois faire vite. Je me dépêche. J'enfile mes chaussures à la hâte. À peine le temps de mettre mon manteau, les manches encore au niveau des coudes, que je plonge la tête la première dans un océan de verdure à l'odeur florale et estivale. J'atterris en douceur, le pied léger, tout en volupté dans le jardin d'un inconnu. Toujours le même village. Un voisinage différent. Toujours une forme de simplicité. Des couleurs différentes.
Les herbes hautes se dégradent en nuance de vert. Du clair au foncé. Une majorité de clair, de jeunes pousses, souples et ignorante de l'éphémère. Les fleurs égrainent leurs couleurs, des couronnes de pétales blanches, roses et rouges. On ne le voit pas ici, mais je sais qu'un vilain liseron s'emmêle quelque part dans ce jardin, sous mes pieds même peut-être.
Des arbres modestes bordent le carré privé. Des buissons bleutés, des chardons au zénith. Ils tempèrent les couleurs chaudes de la cohorte florale et du fragment de ciel suspendu au sommet de la dextre.
Les bâtiments anonymes ressemblent à de simples façades. Une grange quelconque. Une masure à tout faire. Je lui imagine toutes les histoires possibles. Je flâne, le pas lent, la main caressant les herbes. Le vent me chatouille les oreilles, y murmurent quelques secrets avant de repartir aussitôt riant. C'est un jardin paisible, loin du bruit et de la fureur humaine. Je puis y reprendre mon souffle après cette longue semaine. Saturer mes sens des parfums de bon sens d'une Petite Nature encore existante.
12 décembre 2025
030. Champs de coquelicots
La journée s'étire, inutilement, inlassablement. Le soleil refuse d'embras(s)er l'horizon. Les étoiles tardent. L'azur persiste, résiste à la marée noire. De ma fenêtre, je fais des ronds de fumée, la cigarette se consume sur le rebord du cendrier. La lavande et l'eucalyptus embaume la pièce. Un parfum douillet. Sous le néon, assis à la table, j'attends, le regard cloué à la maudite horloge. Je guette le mouvement des aiguilles. Je maudis leur lenteur ; surtout la petite. Je voudrais me défaire de cette chaîne, me lever libre et voyager ; plonger dans la toile sans attendre. Pourtant, il le faut bien. Attendre.
Une inspiration profonde. Légère. Estivale. Florale. J'ouvre les yeux sur une population vêtue de rouge, le pétale puissant, aguicheur ou plutôt charmeur. Un champ entier, à perte de vue, remontant jusqu'aux montagnes. Ici et là, des arbres girafes, de grandes perches à la tête grosse et feuillue. Un géant les a posés là avant de les oublier. Ils jurent avec le reste. Mais trop tard, ils ont pris racine dans le paysage. Personne ne viendra les en déloger.
À la mer terrestre répond l'océan céleste. Un océan, car les couleurs, les reflets et les traits en revêtent tous les aspects. Derrière le jaune espoir s'étend le bleu mélancolique. Un masque de façade, puis le véritable visage, l'humeur du cœur, la couleur de la bile et du sang royal.
Je me laisse tomber à la renverse. Je rebondis doucement contre la terre fraîche. Les coquelicots me chatouillent les oreilles. J'en cueille quelques-uns dans l'idée de les faire sécher. Une tisane de leurs pétales nourrit les rêves les plus déjantés.
11 décembre 2025
029. La Petite Rivière
L'eau clapote, serpente entre les joncs et s'échoue paresseusement sur les berges enquenouillées. Les épis, pareil à des feux de Saint-Jean, se dressent, ondulent vers des hauteurs toutes relatives. Devant mes pieds, ils laissent l'empreinte d'un sentier courir le long du lit. La Petite Nature m'enjoint à l'accompagner, à escorter la rivière jusqu'à l'estuaire. Une eau sombre où se réverbèrent les jaunes comme les verts, et surtout le ciel, encre profonde, taillé furieusement en traits épais, une pâte dense dépouillée de ses étoiles. Car la nuit n'est pas. Pas encore. Pourtant, il fait froid et sombre. Le vent s'amuse lui aussi, comme à sa saison. Une nouvelle fois, pas encore. Ni nuit ni automne. Mais alors, quelle saison ?
Je continue de suivre le sentier tout tracé. Je choisis la facilité. Je passe sous les ramures de quelques arbres au feuillage dru. L'air embaume la sève et un parfum floral. La rivière ajoute aussi son bouquet humide, de glaise, de mousse et du recyclage des petits êtres. Des libellules et des insectes de classe sociale moindre zigzaguent entre l'eau et le sentier. Ils profitent d'un festin larvaire qui m'est invisible. Leur bourdonnement nourrit le clapotis tranquille de la rivière. Parfois, un oiseau s'affirme tout là-haut, perché, à l'abri d'un nid peut-être.
Je m'imagine pique-niquer et rêvasser le reste de la journée. Le lieu est paisible, comme arraché à la frénésie du monde, étranger à l'industrieuse humanité. On pourrait croire la Petite Nature vierge si ce n'était le sentier. Une marque modeste, une alliance peut-être même, un partage entre l'être et son espace, un respect mutuel avant la grande dégringolade.
10 décembre 2025
028. Vignes avec vue d'Auvers
Loin des étoiles errent des planètes solitaires que nulle lumière n'éclaire. Elles dérivent vers l'infini, privées de révolution, car sans centre de masse où rebondir. Des roches anonymes, inconnues, perdues. Cette image me hante, alors je reviens vers la toile, en quête de lumière et de vent, de couleurs et de printemps.
Les coquelicots sont de la fête. Sous la fine brise, ils dansent, se trémoussent et offrent leurs pétales au doux soleil. Les vignes murmurent, travaillent à sucrer le raisin. Un dur et précieux labeur que de préparer le millésime de demain. Je suis en avance, de quelques semaines, de quelque mois. Je n'aurais pas l'occasion de goûter une grappe, pas même un grain.
Le village m'apparaît moderne. Cette clôture blanche se joue de mes repères temporels. Les nombreuses maisons aussi. J'ignore pourquoi, mais une auto ne me surprendrait pas sur la route, plus bas, serpentant dans le quartier. Banlieue pavillonnaire d'une petite bourgeoisie écrasant l'agraire. Drôle d'idée pour un paysage loin dans le passé.
Au loin les montagnes, comme à l'accoutumée. Lisse, les contours adoucis par le vent, les arêtes polies. Aucun risque de s'asseoir au sommet, pas même un benêt ne s'y blesserait les fesses. Quelle vue de là-haut ? Le village entier et le reste de la plaine ? Et aujourd'hui, mon aujourd'hui, que reste-t-il des peintures d'antan ? Quel pigment a réussi à échapper à l'Homme et au Temps ?
09 décembre 2025
027. Paysage d'Auvers après la pluie
Le dos raide, je glisse du lit. Lentement, je me redresse, les mains sur les hanches, un petit vieux qui n'a pas le compte des ans. Ces dernières journées m'ont fatigué. Le corps me rappelle à l'ordre. La douleur fait raison. Je dois davantage le respecter. Pourtant, je ne puis m'en empêcher. L'occasion est trop belle. La toile d'aujourd'hui respire le vert, une petite Nature légère, vivace d'une pluie tombée la veille. Les rideaux ont cessé d'obscurcir le ciel. L'éponge est passée. Je le plonge sans même y songer.
La vue s'étend loin vers un horizon ferroviaire. La machine à vapeur nourrit les propres vapeurs du ciel. Le charbon chauffe. L'eau bout. La vapeur travaille. Les engrenages tournent. Le tout s'enraille sur de longues distances. La modernité en arrière-plan. Une modernité encore sobre. Pas encore imbue d'elle-même. À ce stage, elle cohabite avec le paysage. Elle ne l'a pas dévoré, mis tout entier dans son ventre. La petite Nature domine largement. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Un seul mot d'ordre, profiter tant qu'on le peut encore.
Effet de contraste, une charrette s'aventure sur le sentier, en contre bas, entre le train et moi. Un cheval travaille fort ou bien est-ce un âne ? Partout des champs. Des rectangles aux droits angles. Des parcelles bien dessinées. L'empreinte des miens structurent les sols. Une autre forme de modernité marque déjà ces terres. Une ingénierie agricole qui dénature en profondeur. Près de moi, un paysan sue sous le ciel, à la fauche. Sa vue me rend triste. Le fait que le sens de son existe s'étiole, ses cendres emportés sous le souffle d'Éole.
08 décembre 2025
026. Champ de blé avec une maison blanche à Auvers
La tasse de café fume dans la pénombre de la cuisine. Le néon, fébrile, clignote au rythme de la tension. L'électricité peine à sillonner les veines cuivrées. Le froid matinal met à rude épreuve l'alimentation centrale. Si les choses ne s'améliorent pas, je fendrai du bois, quelques bûches pas plus. La maison se taille modestement. Une pièce centrale, unique, pas une chambre. Une forme originale avec ce long couloir au bout duquel pend la toile. Du coin de l'œil, je le vois. Je devine ses couleurs. Des couleurs joyeuses, entraînantes, festives. Une couche de vie par-dessus le morne gris, le monochrome dépressif.
La tasse de café ne fume plus. Je l'ai bue d'une traite avant de me lever, de m'habiller des pieds à la tête, le buste cintré dans mon veston. Les manches m'arrivent à peine au poignet, mes chaussures trouées respirent à leur aise et la reprise sur mon pantalon se défait. Je soupire et éteins le néon. Il soupire lui aussi, un maigre râle électrique. L'ombre s'abat sur la cuisine comme un voile qui soudain tombe. Une lumière demeure, la toile et ses couleurs.
Une seconde et je plonge. La chaleur envahit mes poumons. Des parfums nouveaux s'emmêlent dans mes narines. Ça bouchonne là-dedans, personne ne respecte le sens des priorités. Éole me chatouille le cou. Je n'ai pas emporté d'écharpe. La peau nue, lisse, nette, offerte à la rigueur de l'hiver. Non, l'hiver se tient loin de ces lieux entoilés. Ici, le printemps règne. Peut-être une prémisse d'été. J'ouvre ma veste de quelques boutons. J'inspire profondément les pollens qui hantent l'air. Je découvre une parcelle piquetée d'or et d'émeraude : des blés à l'orée de la maturité.
07 décembre 2025
025. Les Chaumières dans Jorgus
Le sirocco emporte les sables sahariens jusque dans cette peinture. Le jaune trouble la vue ; il teinte le chaume, le ciel et les sens. Il recouvre la matière d'une pellicule, d'une sorte de mousse, presque verte, presque un lichen pendu aux nuages. Et malgré le vent, malgré son souffle, il en vient toujours plus dans la danse. Les particules valsent, tournent, s'enivrent de la perte des sens et de la joyeuse ronde des éléments.
Je me couvre le visage d'un masque de fortune, un simple morceau de tissu. Je plisse les yeux pour les protéger des grains qui voltigent dans la tourmente du temps. Je ne suis pas seul. Deux paysannes s'aventurent en dehors de leur logis, profitent de la vivacité de la météo, s'en imprègnent, espèrent qu'en cela une énergie nouvelle coulera dans leurs veines. Je doute qu'un tel sortilège fonctionne. Je les plains, le dos courbé par le labeur d'une vie et le poids des années. Elles avancent lentement, brusquées par les vents, chahutées par Éole qui, malin, souhaite les faire trébucher.
Un espoir perce la toile. Une flamme bleue colore la robe, une étincelle chaude brille au milieu du Cireux. Ce bleu garde toute sa saveur, sa puissance, sa profondeur. Il vit, transcende la fadeur morose des jaunes dégorgés. Aujourd'hui, le bleu ne joue pas à la mélancolie ; au contraire, il s'affirme plus que jamais comme un rempart au repli, contre l'inertie. Ce bleu veut conquérir les lichens, les mousses et les chaumes jaunis. Ce bleu s'ambitionne plus qu'aucune autre couleur. Il se rappelle qu'autrefois il régnait en maître incontesté du ciel. Il rêve encore de son trône tout là-haut, de sa couronne, de son spectre et de l'orbe.
06 décembre 2025
024. Branches d'acacia en fleur
Épaisseur et relief. La truelle plus que le pinceau. Des branches avant un samedi de décembre. Des fleurs pour rappeler le printemps. Vif et abstrait, je découvre un peu plus le sujet à chaque nouveau regard. Au premier, je n'y comprenais goutte. Rien. Je ne reconnaissais rien. Des formes absurdes et hasardeuses. Mais dès le second, comme un sortilège autant un voile, je discernais enfin la branche, ses feuillages et ses fleurs. Un trait épais et gras pour une feuille ; une feuille richement nourrie, bardée des rayons d'un soleil généreux, pleine de chlorophylle à s'en exploser les nervures. Les fleurs demeurent plus abstraites. Il me faut davantage d'effort pour me les figurer, le pétale trouble et le cœur brumeux. Dans le fond, un épais feuillage. Oui, lui aussi épais. Tout dans cette toile est affaire de volume, de densité, d'épaisseur, de poids et de couleur.
Et pourtant, rien n'étouffe ici-bas. Sous cette fameuse branche fleurie, mon esprit divague, s'épanouit. La fatigue guette, je sais que je n'irai pas plus loin aujourd'hui. Je m'assieds au pied du vénérable acacia, le salus en ôtant mon chapeau et enfin les paupières closes, je visite le repos. Et là, sans un mot : dodo.
05 décembre 2025
023. Les Roses
Le soleil dort encore sous l'horizon, mais la nuit bat de l'aile. Le scintillement des étoiles faiblit. La lune rassemble autour d'elle des nuages épars ; elle compose son édredon ; elle prépare son coucher journalier. À l'inverse, je me lève, les yeux bouffis, les poches cernés jusqu'à la commissure des lèvres. Les rêves persistent en écho dans mes oreilles, des sons creux, des images fades, des odeurs absentes. Je ne rêve jamais d'odeur. L'onirisme ne gagne jamais ce sens chez moi. Peut-être est-ce le cas de tout un chacun ?
Après un coup d'eau sur le visage, un brossage de dents réglementaire et la mise de la tenue adéquate, je m'engouffre dans le couloir, fais face à mon tableau. Le cadre, surpris de ma volonté matinale, sursaute. Légèrement, il penche sur la droite dans un grincement froid. La toile s'annonce verte, humble, un autre genre de portrait où les miens n'ont pas leur place ; à la place se tient par un avatar de la Petite Nature, des roses.
Aujourd'hui, les verts envahissent en effet. Ils sont multiples, nombreux et complets. Par ailleurs, le métal se joint aussi à la variante colorée ; le cuivre oxydé du pot expose ses plus beaux artifices colorés. Mais pour le reste, le végétal règne sur les verts, du plus clair au plus foncé, en passant par le vert à l'orée du brun marronné, ce vert friable, en quête de lumière, d'eau et d'été.
Les roses explosent de blancheur au cœur du panier végétal. Elles se dressent pour les unes, hautes et fières ; elles sombrent pour les autres, les pétales bas, éparpillés dans l'herbe. Certains en sont même dépouillés, flétris, tout ramassés sur eux-mêmes. Le bouquet nous révèle l'entièreté du cycle, l'éphémère à chacun des âges. Je frissonne à l'idée que des Titans puissent faire de même de nos personnes.
04 décembre 2025
022. Le Docteur Paul Gachet
Le capitaine n'a pas bougé. Le fond a changé. Les traits se sont estompés ; un seul demeure, l'horizon qui ondule, la mer par-dessus la mer, les vagues montantes. Et la digitale attend toujours, libre, sans verre, et le vert de ses feuilles sèches aussi, évanescent. Ses clochettes bleuissent, assoiffées, avides de barboter par le bout de la tige.
Encore un portrait, le même, et une nouvelle fois, j'ignore quoi dire, quoi faire. Je croyais m'être détourné de l'homme, mais me voilà de retour au point de départ. J'ai fait la révolution. J'ai tourné. J'ai parcouru l'ellipse tout entière. Peut-être suis-je prisonnier ? Peut-être chaque jour, désormais, j'aurai rendez-vous avec le docteur marin, sa casquette vissée sur la tête, son manteau sur les épaules, la mélancolie greffée à la rétine Des yeux errant dans les déserts arctiques, là où le soleil s'extrémise.
Cette fois, je m'assieds à ses côtés, le dos cassé par l'angle droit du tabouret. Je l'écoute respirer ; une respiration encombrée, enfumée sûrement, profonde et fatiguée. Une odeur d'herbe à pipe plane dans la pièce. Si nous étions en mer, nous sentirions le sel. Bien sûr, je ne dis rien. Je reste à ma place et le bougre ne me remarque pas. Invisible à son regard cristal, mais quelque chose l'avive. Ses joues reprennent des couleurs. Le gris chavire sous une nouvelle forme de chaleur. Un léger rouge gagne ses pommettes, saillantes au-dessus de ses joues creuses.
Il arrive que les personnages me remarquent inconsciemment. Ils sentent une présence, sans plus de détails. La solitude ne les écrase plus. Ils savent qu'un témoin les observe, qu'une âme amicale se fait témoin de leur existence, d'un fragment tout du moins. Cela les apaise. Ils comprennent qu'un étranger gardera un souvenir d'eux, qu'après leur mort ils survivront encore un temps.
03 décembre 2025
021. Portrait du docteur Gachet
C'est la première fois que je confonds un docteur avec un marin. J'ignore pourquoi, mais je trouve que ce dernier métier lui convient mieux. La casquette et le manteau nourrissent clairement ma confusion. Aussi l'arrière-plan, cet étrange mur où s'agite une mer ; ses vagues, hautes et profondes à la fois, cisaillent la vue, rajoutent un horizon et creusent vers les profondeurs bien plus que l'écume ne s'élèvent à l'azur. On croirait ce capitaine perdu, sans bateau, attabler dans un mauvais troquet au port, attendant que la fortune tourne avec le vent ; que le vent le renvoie au large, saturer ses sens d'iode et de sel.
Les portraits ne sont pas mon fort. La preuve, je me méprends quant au métier des gens. À force, cela doit en être vexant. Pour ce bonhomme, non. Il ne s'en formalise pas. La tête contre le poing, le coude contre la table, il attend, le regard vide, errant, fuyant, à la recherche d'un je ne sais quoi. Un vide mélancolique, des pupilles bercées par le passé, nostalgique d'un temps d'insouciance où la définition du mot responsabilité demeurait égarée.
C'est un miroir. Un double du peintre. Tous deux se complaisent dans les bleus, les épousent à merveille et les affrontent les longues nuits d'hiver. La mélancolie les ronge, chacun d'eux. Ils voudraient s'en défaire, l'un par les mots, l'autre par le pinceau, mais est-ce suffisant ? Je ne le crois pas non. L'avenir le confirmera.
J'abandonne ce bon docteur à son errance. Debout, je remarque seulement maintenant le brin de digitale. Le bougre fait trempette dans le verre. Je jette un coup d'œil au vieil homme. Que la mélancolie côtoie ainsi un poison, cela fait rarement bon ménage. Discrètement, je prélève le végétal et le fourre dans ma poche. Rassuré, je pars ainsi le cœur léger.
02 décembre 2025
020. L'Église d'Auvers-sur-Oise
Cela aurait dû être un dimanche, la journée dominicale. Pourtant, c'est un lundi. Un début de semaine. L'ouverture du culte au travail jusqu'au prochain week-end. Peut-être la bâtisse peut-elle changer de religion, remplacer les croyances peintes sur ses vitraux et altérer l'essence de ses icônes. Après tout, partout la mythologie nous entoure, empreigne notre culture, le mirage du mérite, du dépassement, de l'être et surtout du paraître.
Mais non. J'ai franchi la toile, alors l'église qui se dresse devant moi appartient à une religion banale, millénaire, enracinée dans la société ; une religion qui fit le monde après la chute de Jupiter, du panthéon Romain et des Anciens. Mais je ne tiens pas à méditer cela aujourd'hui, cette matinée nocturne est trop belle, les bleus trop profonds pour s'aventurer dans les méandres d'une réflexion.
Le sentier se divise en deux affluents, donnant naissance à une île ; un îlot légèrement surélevé où trône le monument à la gloire de l'hypothétique Père. Les architectes ont raison. Il faut mettre toutes les chances de son côté pour toucher le ciel.
L'église crève les yeux, s'impose, attire le regard, joue de magnétisme et pourtant... Pourtant, c'est le reste qui l'emporte, c'est la Petite Nature qui convainc plus que le Grand Dessein. Le chemin pavé de traits, indiquant le sens de la marche. D'ailleurs, il y a une figure, elle invite à la suivre dans le sens du courant, le sentier s'écoule jusqu'en aval, traverse le village, nous ramène au temps présent, aux gens, aux villageois, à la gaîté d'un samedi soir. À bien y penser, ce sentier remonte certainement le temps.
Surtout, c'est le ciel qui éclipse la demeure du Tout-Puissant. Confrontation entre demeures. Mais ce ciel-là n'a rien d'un paradis céleste. Cette voûte incarne la Petite Nature, les lois intangibles de la physique. Et à bien y regarder, les traits s'incarnent en flamme et tout d'un coup, l'incendie se révèle comme une mer prise par les vents. Des maelstrom ici et là tourmentent le ciel de leur spiral, l'infini chute dans l'espace lointain, à la rencontre des étoiles et des espoirs.
01 décembre 2025
019. Mademoiselle Gachet dans son jardin
Je plaide coupable. Aujourd'hui, je suis un intrus. Non pas que cela ne soit pas le cas à chacune de mes visites. Je m'invite dans chaque tableau sans demander la permission après tout. Mais cette fois-ci, mon méfait ne peut être dissimulé. Voilà longtemps que je n'avais pas franchi une toile pour me retrouver nez à nez avec quelqu'un, une dame en l'occurrence, la fille d'un docteur qui plus est. Bien sûr, elle ne me voit pas. Je reste invisible à ce sens. Mais les autres peuvent l'émouvoir de ma présence. Si je bouge, piétine l'herbe sèche, secoue des buissons et brise quelques branchages, ses oreilles l'avertiront de la présence d'un fantôme, un esprit vaporeux coincé entre deux mondes, piégé dans un purgatoire en peinture attendant une quelconque rédemption.
Je n'aime pas tourmenter les sujets des tableaux, alors je m'écarte aussi discrètement que possible de la jeune femme, lui souhaitant une belle journée d'un murmure. Je la contourne, mais reste dans le jardin. Je navigue entre les fleurs, gorgées de soleil et de printemps. J'inspecte les pots, bleu, orange et brun. J'y note les nervures, les pétales et les cœurs. Je souris quand des petits rongeurs courent de broussaille en broussaille. Les orvets y serpentent aussi, plus joyeux que d'autres rampants. Je découvre un hérisson caché sous un tas de bois morts. En pleine digestion, il attend que la nuit le réveille. Là aussi, je souris.
L'air apporte son lot de parfums. Mon nez en est plein. Cette journée se marque d'un calme olympien. Les cyprès ondulent à leur manière, trait par trait leurs courbes se dessinent, les élèvent jusqu'à toucher le ciel. Lui aussi se marque de la frénésie du geste, tantôt bleu, tantôt blanc, les nuages gonflent cet après-midi. Si le calme règne, la tempête s'annonce. Éole dort encore, mais ne devrait pas tarder à se lever. Je ne souris plus. Les paupières closes, j'imagine le ciel s'obscurcir, le roulement du tonnerre, le fracas des éclairs, le jardin rincé, en berne, les rideaux de pluie claquer. Une vision. Un présage. Une réminiscence. Un désir de voir les éléments s'épanouir et rappeler la vitalité de la Terre.
30 novembre 2025
018. Maisons à Auvers-sur-Oise
Le vent siffle, crie et ébouriffe. Les pans de mon manteau claquent contre mon pantalon. Le froid tente de se frayer un chemin à travers la laine et le daim. Bien emmitouflé, prévoyant cette fois-ci, je m'enorgueillis d'avoir chaud au cœur de la bise. Les hauts arbres ballottent et grincent, un couinement presque. Les nuages s'amoncellent rapidement, se chargent et n'attendent plus que le signal de la dépression pour déverser leur rideau.
Le vent fait trembler les tuiles. Il tente de les soulever, de se glisser à l'intérieur de la bâtisse. Le bâtiment a été fait d'une main savante, Éole devra encore œuvrer longtemps avant de s'engouffrer sous la charpente.
Personne à l'horizon. Chacun s'abrite sous son toit, bien au chaud, attendant que l'ondée passe. Je suis seul, planté dehors sur le sentier, devant un muret bordant le potager. Je regarde le ciel, le nez en l'air, les yeux plissés, l'esprit vagabond, vide de tracas, avide d'errance et d'espérance. Je reste immobile, j'attends de faire partie du décor, de compter pour un élément de la Petite nature, de me joindre à sa cohorte végétale. Après tout, je suis un animal.
Le ciel gris m'intrigue. Ses traits, ses volumes, ses gris. Gris. Gris. Gris. Blanc pour le relief, le moutonneux, le cotonneux. Un gris sombre annonciateur d'orage. Orage d'été. Ondée d'été. Tempête estivale. Les éclairs crépitent déjà là-haut, encore invisibles ; ils s'entraînent ; ils répètent avant de jaillir de la trouée céleste, de zébrer la voûte d'une élégante manière.
Voilà ce que j'attends, le nez en l'air, les deux pieds plantés sur le sentier : le merveilleux spectacle des éléments.
29 novembre 2025
017. Racines d'arbres
Il y a erreur sur le tableau. La liste les promettait par période et ordre chronologique. Pourtant me voici déjà rendu au dernier. Des racines. Comme la vision d'un homme qui s'enterre. De chaque côté, la terre s'élève, masque le ciel et le soleil et le recouvre d'une ombre humide et grouillante, où respirent paisiblement les réseaux chthoniens. Des racines bleues, grises, presque violettes ; des membres frigorifiés, attaqués par l'hiver, comme à l'orée de l'engelure en altitude.
De mémoire, ces racines se vautrent sur un épais talus en bordure d'une route, large et entretenu, suffisamment pour la descendre en bicyclette. La vision est bien moins sinistre qu'elle ne le laisse présager quand on reconnaît l'endroit d'où provient la toile. Mais un certain esprit demeure malgré tout, une frénésie, une hâte, une précipitation à finir l'œuvre pour s'engager rapidement ailleurs.
Il est curieux de deviner du mouvement, une forme de dynamisme, la mise en route des énergies, là où par essence, la vie s'enracine, statique et discrète. La Petite Nature a coutume de se mouvoir sur le temps long, de tracer sa route avec une infinie patience, jouer des rapports de force presque invisibles à nos yeux.
Je ne saurais donner la saison. La palette m'évoque un automne sur le tard, se préparant à l'hiver. Les intensités ont pâli. Elles ont fané, évanouies, emportées par les vents au-delà des mers et des océans. Pensif, je me hisse sur le talus et m'assieds entre les troncs dénudés, les pieds calés contre les racines. Je bourre ma pipe d'un vieux tabac trouvé un peu plus haut sur le sentier, une petite poche abandonnée par quelque esprit égaré. La première bouffée me fait tousser. À la seconde, la tête me tourne, légèrement. Alors que le ciel s'assombrit, le ciel scintille entre les ramures et les murmures.
28 novembre 2025
016. Chaumes de Cordeville à Auvers-sur-Oise
Ce matin, le réveil sonne et mes paupières papillonnent. Engourdi, je me redresse, rejette les couvertures en travers du lit et m'assois au bord. Je prends trois longues inspirations, de grandes goulées d'air frais afin de réactiver mes poumons des alvéoles jusqu'aux bronches. Je me gratte la tête, le visage bouffi, certainement marqué par l'oreiller. Je plisse les yeux sous la lumière. Ma bouche pâteuse goûte le dîner de la veille, transformé, retravaillé ; c'est un reflux digestif qui a mariné toute la nuit. Je m'ébroue sous un filet d'eau à la salle de bain. Je me passe rapidement un gant de toilette sous les bras. J'enfile les vêtements adéquats. En moins d'une dizaine de minutes, je me tiens prêt devant la toile au fond du couloir. Je prends une dernière inspiration avant de plonger, comme un nageur au top départ. Autour de moi, l'air se charge d'électricité, une tension grésille, la toile s'agrandit et d'un pas, je passe et la peinture m'engloutit.
Je me retrouve sur un sentier ou peut-être un chemin, plus large, bien dégagé, en bordure d'habitations couvertes de chaume et d'un jardin en longueur qui remonte la pente. Un vent de caractère souffle aujourd'hui. Ses dents mordent mes joues et me glacent jusqu'à l'os. Autour de moi, je découvre seulement des couleurs d'hiver, des teintes sans intensité, dépourvues de chaleur, vidées de toute énergie solaire. L'énergie tient au mouvement ; elle est l'apanage du vent. Les hautes herbes ondulent, les arbres aussi, ils tanguent et grincent, de véritables navires pris en pleine tempête, coincés dans le creux entre deux vagues.
Peut-être n'est-ce qu'une vision de nuit. Les couleurs dévorées par l'obscurité, réduit à une essence pâle d'avoir été. Et au fond du ciel, là au centre, une pleine lune ennuagée, suspendue sur une toile noire grignotée de gris. C'est peut-être la saison des grands vents d'été et je me trouve au cœur d'une nuit fraîche, silencieuse à l'exception d'Éole qui nous coupe à tous la parole. La Petite Nature essaye bien de dire un mot, mais les rafales rabrouent le premier venu qui s'essaye à en placer une.
Là-haut, je distingue un bosquet coiffer le tertre. La lune l'inonde avec bienveillance, ses verts ressortent pâles et fantomatiques. J'imagine quelques esprits le peupler, des esprits anciens des temps jamais revisités. La curiosité guide mes pas vers un maigre sentier qui y monte. La terre est sèche, dure, gravillonnée. Les poumons glacés, malgré les fragrances d'été, ceinturé des vents, je m'arrête à mi-chemin, les yeux rivés sur le gros lampadaire. Je m'interroge un instant, avant d'oublier. Parfois, il faut savoir se taire, regarder sans méditer.
27 novembre 2025
015. L’escalier d’Auvers avec deux personnages
Des escaliers. Ces escaliers. Une nouvelle fois. Je tourne en rond dans le village. Me voilà revenu sur les lieux d'une œuvre peinte, à ceci près que la population a changé. Seules deux personnes descendent le sentier aujourd'hui et personne n'emprunte l'escalier. Le vieil homme a fini par rejoindre sa chaumière, malgré son faible rythme et ses rhumatismes. Moi, pareil à la fois dernière, je regarde vers l'escalier, la vue plongeant vers le fond du sentier.
L'exercice de la toile se corse avec la fatigue. Je trébuche davantage. Mes idées s'emmêlent, mes doigts aussi. Une légère migraine bat à l'avant, contre mon front, elle pulse, un charbon ardent rayonne au coin de l'œil. Mes yeux se plissent, fatigués des torrents de lumière. Ils la régurgitent, gavés comme des oies à l'approche du solstice d'hiver. Néanmoins, je finis par m'ancrer dans la toile. Mes sens rencontrent les frémissements de la Petite Nature. Nos conversations reprennent.
La saison est la même. Je suppose. La palette de couleurs demeure inchangée, seulement gagnée par une forme d'intensité. Les jaunes particulièrement. Ils dégagent une chaleur torride, qui envahit le sentier, jusqu'à déborder sur la végétation. Sur les pierres, des lichens aussi jaunissent, rejoignant la horde rappelant le soleil. Fort heureusement, ici, nous restons à distance d'un quelconque roi en jaune, cette mythologie n'est pas encore née. Il faudra attendre encore quelques années.
Je pourrais m'attarder sur les tuiles et le liseré bleu et discret du ciel. Mais mes paupières papillonnent, mon estomac gargouille, la tête me tourne, un peu. Je m'adosse contre la pierre, en bordure du sentier. Je sens la sueur perler sur ma joue. J'ai chaud. Une bouffée de chaleur. Ici c'est le plein été. Chez moi, c'est le cœur de l'hiver. Me voilà malin à confondre les saisons entre la toile et ma maison. Un bel imbécile de me pavaner ici emmitouflé de laine de la tête au pied.
26 novembre 2025
014. Ferme
Au débouché d'un sentier, une ferme remplit l'espace. Large et bien ventrue, la généreuse bâtisse ne passe pas inaperçue, loin de là. Ses angles fondent en courbe, comme amollis par le temps ou sous l'effort de porter une si lourde toiture. Les tuiles ondulent à la manière des vagues. Une maison océan, le dernier vestige d'une Atlantide. Peut-être est-ce là le vilain tour du vent, qui de son souffle tort les lignes et les forces en arc ? Ou bien, dois-je plutôt accuser l'ivresse ? La boisson m'aura privé d'un droit horizon.
Autour de la ferme, les habitants s'activent. Il y a toujours quelque chose à faire à la ferme. Des vaches à traire, des moutons à tondre, des biquettes à rentrer, un poulailler à verrouiller, les champs à labourer. Ce n'est pas le travail qui manque, ni sa diversité, pour ceux qui apprécient s'aérer. Les lierres rampent sur les murs, au ralenti si bien que les croit immobiles. Belle illusion. Ces vilains s'agrippent solidement au mur. Rien, sauf une volonté motivée, ne pourrait les déloger. Un esprit esthétique les remplacerait par des rosiers. Quitte à végétaliser, autant profiter des épines et des fleurs. Les premières pour se défendre, les secondes pour la beauté.
L'atmosphère des lieux se fait moussue. Du ciel jusqu'à la terre. Un vert recouvre l'entièreté de la lumière, comme si ma vision venait d'être extirpée d'un marais. Un vert lichen, un vert mousse, un vert tourbe, un vert stagnant s'attaque à tous les espaces. Il envahit jusqu'au ciel. Le bleu peine à s'exprimer ; il tourbillonne quelque peu pour lutter ; une lutte vaine, car a priori, seul le vert est en veine.
Je m'éloigne de la ferme après l'avoir longée. Je laisse les paysans à leur labeur. Je retourne au mien, bien plus léger, marcher, errer, m'entoiler sentier après sentier.
25 novembre 2025
013. Vue d’Auvers
Le village se dresse en contrebas, planté au milieu des champs et des prairies peintes de quelques traits fouillis. Les toitures alternent entre l'ardoise et la tuile ; la plupart, fortement pendues, invitent au vertige que le maçon et ses amis ignorent. L'alternance des couleurs rehausse les verts de la Petite Nature. Voilà une belle harmonie conquise.
Les bâtisses s'élèvent hautes. Elles m'apparaissent comme sur la pointe des pieds, grappillant les centimètres d'un enfant. Quelques-unes, au contraire, s'affaissent sur elles-mêmes, prêtent à s'enfoncer sous terre et rejoindre les racines des vénérables ancêtres.
La vue d'aujourd'hui m'inspire peu. Du haut de ma colline, l'épaisseur du trait me trouble plus qu'autre chose. Je ne sais pas quoi en penser. J'ignore quoi en dire. Peut-être vaudrait-il mieux ne rien écrire ? Me taire et rester à contempler les bleus et les verts s'agiter sous la brise printanière. Peut-être.
À bien regarder le ciel, l'avancée nuageuse a ceci d'étrange qu'elle m'apparaît percée de bleu et non l'inverse. Le pinceau imbibé d'azur a effacé le ciel gris et morne, maintenant j'en suis sûr. Le geste a serpenté dans la masse ; il a tracé des sillons ; sauté d'une ornière à l'autre et percé le gris sinistre.
Les couleurs pastels apaisent. Leur douceur n'avive aucune fureur, aucune passion dont le maître a l'habitude. Ici, la vue se vit paisible, vivifiante sous une brise, frémissant sous les feuilles bourdonnantes.
Peut-être n'ai-je rien à dire, mais forcé de constater qu'il m'importe de rester ici, bien assis contre un tronc dégarni sous l'insistance d'un vieil orage. La tête dans les nuages, j'observe la bagarre engagée contre l'azur. Du haut de leurs cimes, les arbres prétendent rejoindre le conflit. Malheureusement pour eux, ils s'enracinent trop bas ; même les pins alpins demeurent derrière les lignes. Un aigle passe devant le soleil. Son ombre joue à l'éclipse. Le rapace tourne et glatit. Le royal emplumé a faim lui aussi.
24 novembre 2025
012. L'Escalier d'Auvers
Ce jour-là, une agitation légère anime l'atmosphère. Un peu de vie égaille le village, ses rues et son escalier. Quelques âmes palabrent entre elles, à mi-voix pour certaines, en francs éclats pour d'autres. La journée bien avancée, le sommeil oublié en un coin reculé, l'énergie avive les veines. Les pieds bien chaussés crissent délicatement sur le sentier gravillonné ; les chapeaux coiffent les têtes pour les protéger du soleil ; les robes prennent de curieuses formes sous les caprices d'Éole.
Le soleil m'éblouit. La blancheur du sentier s'intensifie à chaque rayon. Je détourne le regard, une myriade d'étoiles noires au fond des yeux. Je me raccroche à la végétation sèche, naine, qui pousse entre les pierres. Celle-ci, moins vive, ne blesse pas mon regard. Aujourd'hui, je n'ose lever les yeux au ciel. Je suspecte la profondeur d'un ciel d'été, un azur à s'en noyer, un soleil radieux brillant d'une intensité inégalée. Je me contente des basses œuvres terrestres, des bâtisses à l'échelle des miens, faites de leurs mains.
L'escalier monte. Ou bien descendit-il ? Un vieil homme emprunt ce chemin-là, vers le bas, la canne en assurance en plus de la rambarde. Lui aussi se coiffe d'un chapeau. Où va-t-il ? Me serait-il permis de le suivre ? Non. Je dois laisser les âmes du tableau errer à leur guise, ne pas les influencer de quelques manières. Leur liberté a un prix, celui de tourner éternellement entre les quatre coins du canevas. Une liberté, si l'on en ignore les limites du cadre.
Pas de ciel aujourd'hui, mais toujours l'abstrait confiné au fond du trait. Le geste saccadé, énergique, mais simple et compréhensible. Une réduction où le mouvement demeure, où l'animation s'imagine sans le moindre effort. J'entends toujours le vent siffler, courir le long des rochers, avant de poursuivre le long du sentier. Il est partout, dans les arbres aussi et les rares nuages que je ne puis voir d'ici. Les jeunes filles devraient tenir leur chapeau, ils risquent de s'envoler.
Au loin, un épervier crie. C'est l'heure du déjeuner.
23 novembre 2025
011. Branches de marronnier en fleur
Passer le vortex de lin ce matin s’avère plus difficile qu’à l’accoutumée. Ma cervelle défragmente encore les conversations de la veille ; des visages, des bruits, des odeurs, tout un panel nouveau de couleurs. Les neurones ont veillé toute la nuit, à trier les informations et à les ranger en classeurs. Alors ce matin, la toile m’apparaît constamment lointaine, difficile d’accès, malgré la vitalité des nuances et du trait. Mais, je franchis mon long couloir à pas millimétré, sans oublier de me vêtir pour l’occasion, chapeau et cape d’exception. Le visage suspendu au-dessus du village et du pré, enfin, je plonge.
Progressivement, la Petite Nature s’éveille à mes oreilles. Un ru glougloute non loin, et avec lui, ses fidèles batraciens donnent du coffre à l’orée du matin. Une brise légère, mais fraîche, anime les hautes herbes. Elles se balancent sous sa caresse, paresseuses elles se laissent aller. Le pollen lui s’envole, plus déterminé que jamais à décamper du foyer qui l’a vu naître. Il veut voir des horizons lointains, des ailleurs qui signifient d’autres prés.
Pas une âme de mon genre sur ces sentiers. En revanche, j’entends de l’agitation en provenance du hameau. Des morceaux de voix ici et là fusent le long des toitures ; des éclats rigolards accompagnés d’une musique festive, une célébration villageoise égaille les ruelles de l’endroit. Les fleurs du pré s’en amusent. Elles dansent, elles aussi, au rythme de la cadence. Le vent s’harmonise. Quelque chose dans l’air me détend. Une lumière intense brille en ces lieux, mais elle n’a rien d’aveuglant. Elle ne se voit pas d’ailleurs. Elle se devine seulement quand on ferme les yeux.
Par-dessus les collines dominant le village, le bleu s’étend, le ciel chargé de nuages ou d’azur, je ne parviens pas à me décider. Quoi qu’il en soit, la voûte porte un poids, une charge immense sur ses épaules célestes qu’elle semble prête à déverser sur la basse terre. Un simple grain saisonnier ? Une tourmente d’éclairs ? Qu’importe, toujours les fleurs danseront ici, j’en ai l’intime conviction.
22 novembre 2025
010. Les Vessenots à Auvers
Passer le vortex de lin ce matin s’avère plus difficile qu’à l’accoutumée. Ma cervelle défragmente encore les conversations de la veille ; des visages, des bruits, des odeurs, tout un panel nouveau de couleurs. Les neurones ont veillé toute la nuit, à trier les informations et à les ranger en classeurs. Alors ce matin, la toile m’apparaît constamment lointaine, difficile d’accès, malgré la vitalité des nuances et du trait. Mais, je franchis mon long couloir à pas millimétré, sans oublier de me vêtir pour l’occasion, chapeau et cape d’exception. Le visage suspendu au-dessus du village et du pré, enfin, je plonge.
Progressivement, la Petite Nature s’éveille à mes oreilles. Un ru glougloute non loin, et avec lui, ses fidèles batraciens donnent du coffre à l’orée du matin. Une brise légère, mais fraîche, anime les hautes herbes. Elles se balancent sous sa caresse, paresseuses elles se laissent aller. Le pollen lui s’envole, plus déterminé que jamais à décamper du foyer qui l’a vu naître. Il veut voir des horizons lointains, des ailleurs qui signifient d’autres prés.
Pas une âme de mon genre sur ces sentiers. En revanche, j’entends de l’agitation en provenance du hameau. Des morceaux de voix ici et là fusent le long des toitures ; des éclats rigolards accompagnés d’une musique festive, une célébration villageoise égaille les ruelles de l’endroit. Les fleurs du pré s’en amusent. Elles dansent, elles aussi, au rythme de la cadence. Le vent s’harmonise. Quelque chose dans l’air me détend. Une lumière intense brille en ces lieux, mais elle n’a rien d’aveuglant. Elle ne se voit pas d’ailleurs. Elle se devine seulement quand on ferme les yeux.
Par-dessus les collines dominant le village, le bleu s’étend, le ciel chargé de nuages ou d’azur, je ne parviens pas à me décider. Quoi qu’il en soit, la voûte porte un poids, une charge immense sur ses épaules célestes qu’elle semble prête à déverser sur la basse terre. Un simple grain saisonnier ? Une tourmente d’éclairs ? Qu’importe, toujours les fleurs danseront ici, j’en ai l’intime conviction.
20 novembre 2025
009. La Maison du père Éloi
Ce matin-là, au réveil, mes paupières collaient. J’avais pleuré dans mon sommeil. Cela faisait longtemps que je n’avais pas senti le goût du sel sur mes lèvres. Je ne me souviens plus de la scène ; il y avait des silhouettes, l’une d’elles s’en allait, je tentais de la retenir, peut-être. Le passage à travers la toile m’a remis l’esprit à l’endroit, séché les recoins que les larmes avaient lavés ; une cervelle fraîche et proprette pour découvrir un nouveau fragment d’autrefois.
Après le vortex de lin, j'atterris au cœur d’un jardin, près d’une maison haute, sinon surélevée. Le petit terrain privé ressemble à un vignoble personnel, promesse d’un vin à la santé du fameux Seigneur. Après tout, je me trouve en terre sacrée, sur le domaine d’un prêtre.
Un fort grain abîme ma vision. La qualité laisse à désirer. Je peine à avancer entre les couleurs et les traits. Je guette à travers mes sens les échos de la Petite Nature, mais je n’en trouve guère. Un oiseau ici et là, des ombres furtives disparaissant dans le ciel. Une légère brise agite les feuillages. Un subtil froissement végétal anime le jardin, le vivifie d’une présence vitale, comme un murmure attentionné qui dirait : “tu n’es pas seul, voyageur”.
Le mur haut, la toiture pentue, la maison domine son pré carré. Une absence de symétrie la rend borgne, une fenêtre en moins, l'œil arraché, condamné à la suite d’un tragique accident, d’une tempête peut-être. Les cheminées, au nombre de deux, sans doute des jumelles, tendent leurs briques rouges au ciel. Elles apportent le contraste ; elles luttent contre la royauté céleste ; elles en oublient de fumer.
Et de ce ciel, un nouveau bleu en traits épais, mais pas seulement. Mes yeux s’attardent longuement sur la couverture nuageuse qui déborde des habitations. Ses teintes se mélangent entre l’azur et un rouge invisible pour accoucher d’un mauve léger, de ces couleurs que seul un crépuscule tardif sait offrir.
Je sors du jardin, cet étrange arbre solitaire en destination. Je lui trouve une allure folle, le tronc dénudé, dépouillé de la moindre ramure. Il m’apparaît comme une tête végétale errante, à la recherche d’une nouvelle terre où s’établir. Entre voyageurs, sans doute aurons-nous de quoi causer une fois que mes pieds rencontreront ses racines.
19 novembre 2025
008. Rue à Auvers-sur-Oise
Je ne reconnais pas mon peintre. Les traits et les couleurs n’éveillent aucune familiarité. Au premier regard, comme tirer brutalement du sommeil, les yeux plissés sous l’éclat solaire et l’esprit encore endimanché, je n’y vois rien, je n’y comprends rien. J’ai beau me tourner et me retourner, le village me fait l’impression d’une terre étrangère, un autre lieu, un autre temps que la peinture de la veille. Et pourtant, ici et là, quand le regard s’attarde et travaille avec une cervelle un peu plus ferme, la familiarité se devine ; dans les traits, les bleus du ciel et le rouge des tuiles moussues, festin éternel des lichens. Les arbres aussi. Les arbres dégagent une prestance que je leur reconnais, une aura croisée les jours précédents. Il me semble que d’un rien, leur feuillage se prendrait d’ivresse, la sève alcoolisée de la pointe des racines jusqu’à la cime, et ondulerait de concert sous la bienveillance du ciel.
Un peu mieux ancré dans la toile, les pieds enfoncés le sentier, je m’engage dans la rue, les yeux déambulant le long des murets et des toitures. Tout est calme. Pas un chat dehors. Quelques oiseaux nichent silencieusement dans les arbres. D’autres s’envolent et piaillent. Pas une âme de mon genre qui vive. Calfeutré au chaud dans leur chaumière ou bien à suer sang et sel dans les champs, à s’occuper du bétail et de la récolte prochaine ? Je mesure mon privilège, l’oisiveté et l’otium des anciens Romains me guident à travers les toiles. En définitive, bien peu d’entre nous peuvent en profiter. L’humanité manque de temps pour les uns et de patience pour les autres. Ces derniers broient les premiers pour en extraire jusqu’à la dernière goutte de volonté.
Les pensées amères s’invitent dans les ruelles du village. Je les chasse en fixant le ciel. Je me perds un instant dans son bleu pastel et ses éclats blancs dont la pluie répond absente. Puis, je m’arrête, je ferme les yeux et respire une longue bouffée d’air, un air silencieux de la démesure humaine, un air assez vieux pour ne pas avoir connu les plus grands malheurs modernes.
18 novembre 2025
007. Dans le jardin du docteur Paul Gachet
L’ivresse des arbres brouille mes sens. La végétation se réinvente, folle et libre à l’occasion d’un grand vent. L’air frais et printanier me frigorifie. Je frissonne. Je l’apprécie. Je sens les rougeurs gagner mes joues, mes pommettes s’assécher légèrement. J’ai le sentiment de ne faire qu’un avec ce bel élément.
Calfeutré dans mon manteau, la casquette vissée sur la tête et les pognes plongées au fond des poches, je déambule sur le chemin penché. L’horizon même semble avoir un coup de trop dans le nez. Les hautes herbes courbées sous Éole évoquent une houle joyeuse, mais ici l’écume ne bouillonne pas, elle fleurit tant en couleurs qu’en senteurs.
Plus loin, le village se dessine, couronné d’une forêt qui moutonne à la manière des nuages lourds du grain à venir. Sous la frondaison, il est vrai qu’en une certaine saison il pleut ; il pleut d’or et d’ocre, de sang et de beige froissé. Mais aujourd’hui, le vert domine les feuillages, certaines fleurs participent même au bal, alors l’automne encore s’oublie au profit de l’éblouissante chlorophylle.
À mi-chemin, je m’arrête. Je reprends mon souffle. Je ne l’avais pas remarqué, mais le bougre me manquait. Le maillot collé à la peau sous mon manteau, je frissonne. Des filets de sueur glacée inondent les vallées au pied de l’échine. Courbé, les mains au grand air sur les genoux, je retrouve un peu de contenance, tandis qu’un drôle de sentiment m’envahit ; pas un mauvais, seulement un drôle, une étrangeté, une idée peut-être même, celui que le ciel s’embrase d’une flamme bleue, marine, accompagnée d’une nacre nuageuse. La mer semble s’être élevée au ciel. Peut-être qu’en ce jour particulier, sur les rivages de la Grande Mer, les nageurs plongent dans une nuit étoilée et que leurs égaiements troublent joyeusement son ancestrale sérénité.
17 novembre 2025
006. La Maison du père Pilon
Le ciel tourne autour des feuillages, une forme d'ivresse céleste faite de bleu et de noir. Un drôle d'arbre auquel appartiennent ces ramures. Il a l'apparence des flammes, d'un incendie végétal perçant la toiture de la masure. L'ancêtre occupe tout mon champ de vision, alors je m'arrête quelques instants pour le détailler, mais surtout pour regarder à côté, découvrir la forêt que cet arbre est censé cacher.
Le chemin s'enfonce sur des terres privées, jalonnées de petites chaumières, maisons ou autres habitations villageoises humbles, modérée, à la taille des femmes et des hommes qui les habitent. J'éprouve toujours un curieux sentiment à les longer, à les observer sur le bord du chemin. Elle rayonne d'une belle humilité, d'une suffisance d'être, d'une absence de honte à ne pas toucher le ciel.
Mes chaussures, taillées pour la marche entoilée, pataugent dans une boue grasse. La terre n'a pas fini de boire la pluie de la veille. Elle la régurgite même. L'ivresse atteint aussi les sols. Eux aussi ont besoin de dégriser de temps en temps sous un soleil de printemps. Les gargouillis spongieux de mes pas résonnent agréablement à mes oreilles. Mes sens s'avivent sous la fraîcheur du vent. La nuit à venir s'annonce froide et paisible. Je le devine à ce ciel emmêlé.
16 novembre 2025
005. Marronniers en fleurs
La solitude a tiré sa révérence. Le marronnier s'accompagne d'un second et envahissent l'espace. Leur feuillage brûlent d'un feu végétal, une incandescence florale d'ocre et de nacre. Sur le contour, le ciel dessine une aura, un charisme ancestral où vibre une énergie vitale, une force de pousser, une volonté de caresser la voûte céleste à force de s'élever. Fine, cette aura s'épuise aux coins de la toile ; elle se fond en encre nocturne, des flammes noires invoquant la nuit.
Toutefois, la lumière brille ici. Dans une ligne, un nuage blanc, éclatant, plus vibrant qu'un soleil au milieu des champs. Il apporte son lot de bonne humeur et les promesses d'une journée sans heurt. Le cumulus guide mon regard vers la bâtisse ; je crois la reconnaître. N'est-ce pas celle d'hier que mon marronnier cachait ?
Aujourd'hui, l'allée s'anime de promeneuses et de promeneurs. Les chapeaux sont de rigueur, car le soleil s'impose au printemps. L'homme à ma gauche déambule curieusement. Sa dégaine et son allure me le rendent sympathique. Presque tordu, il m'apparaît comme un marin sur un pont ballotté par la houle un jour de grand vent. Peut-être est-ce seulement l'ivresse que je romance, que je n'ose attaquer de front pour tout le mal qu'elle inflige à la nature humaine.
Je poursuis ma route. Je passe les dames chapeautées, heureuses de la liberté ensoleillée. Je m'avance vers la bâtisse, immense, sans doute une sorte de restaurant astucieusement placé pour appâter les estomacs affamés. Un blanc de chaux ; une ardoise nette ; une cheminée en brique rouge et sang. Du bel ouvrage qui s'invitera longtemps si l'esprit du propriétaire a à cœur de prendre racine dans le temps.
Mon périple m'attend un peu plus loin. J'imagine un croisement où il guette mon arrivée, incarné dans une silhouette encapuchonnée. Le périple muet serré près du cœur. Le périple entoilé de couleurs et de fureur. Je souris à l'idée que ces deux mots rimes d'harmonie ici et ailleurs.
15 novembre 2025
004. Marronniers en fleurs
Voilà un arbre singulier. Singulier, car solitaire. À qui d'autre le comparer ? À quelle norme le référer ? Cet arbre est sa propre norme. Son écorce contient sa moyenne, sa médiane et toutes autres métriques descriptives. Il n'est pas l'arbre qui cache la forêt. Il EST la forêt de ces lieux abandonnés, privés d'une légion d'arbres plus épaisse, en ligne ou en quinconce. Même s'il s'agite de solitude, cet arbre est beau. Il a pour lui la majesté végétale, bien collée en résine à son tronc. De plus, ses fleurs le subliment de petites touches neigeuses. Des petits névés, ici et là, qui parsèment sa foisonnante chevelure feuillue.
Le marronnier est l'arbre qui cache la bâtisse. Son tronc cache la création humaine. Il l'a dissimule. Il en a honte. Il sait que c'est elle qui a détruit la forêt. Il fait tout pour la couvrir de son ombre, pour l'empêcher qu'elle se dépasse et s'exprime au soleil. Et moi petit erre des toiles, je me retrouve planté là, à l'orée du marronnier, mes pieds à la lisère de son ombre immense et profonde. Elle concurrence le soleil en profondeur et éclat dense. Si je m'avançais d'un pas, elle m'avalerait alors tout entier.
Je sens bouillir une fureur dans les couleurs. Une tension persiste dans certains traits, quelque chose d'électrique, une étincelle à venir, prête à tout embraser. L'intensité de la terre brune, presque sédimentaire à force d'être rongée par les vents et les semelles de chaussures.
Je divague. D'esprit seulement, car mon regard, lui, reste fixé sur l'encre céleste, cette tâche sombre qui déchire le ciel.
14 novembre 2025
003. Fermes près d'Auvers
Aujourd'hui, je bascule à travers la toile dès le matin, dès le levé, avant même que le soleil ne nous révèle sa douce lumière dorée. C'est décidé, le hasard n'aura plus son mot à dire. Je trace moi-même le chemin de toile ; je décide de la direction et du lieu, de la forme et des couleurs.
Même village, pourtant ailleurs. Des masures remplissent l'espace, une longue et épaisse ligne traverse le tableau, crénelée comme une petite chaîne de montagnes. Les toits pentus donnent le vertige sous leurs traits saccadés et nets. Aucune cheminée ne fume. Étrange. On dirait que les esprits ont abandonné leur chaumière.
Derrière, au loin, des rondeurs sculptent l'horizon en hauteur. Leurs sommets polis par les vents se teintent d'un étrange éclat bleuté ; une couleur sombre et profonde qui se s'invente qu'à l'approche du crépuscule, quand la nuit enfin s'invite ou se retire. Mais de nuit, nulle trace à l'exception de celle-ci.
Le ciel lui se colore de douceur, un léger jaune-beige matinal. Les oiseaux se réveillent, piaillent dans les nids, lovés dans la cime des arbres. Ils sont quelques-uns de ces vénérables à piqueter de leur vert les hauteurs du village. Ils ponctuent agréablement la paille monotone des chaumières. Ils ajoutent un peu de vide à ces lieux vides et endormis. Un dimanche matin avant la convocation de l'église.
13 novembre 2025
002. Maisons à Auvers
Ma route reprend. Elle semble suivre un enchaînement logique. Le hasard est à la traîne. Les fils de la trame se tiennent. Je me retrouve en des contrées similaires à celles de la veille, peut-être les mêmes. À bien y regarder, je reconnais un morceau de ciel. La saison, sans doute, diffère, mais pour le reste, la vision se décrit familière.
Je ne suis pas seul. Enfin si. Enfin non. Enfin presque. Une dame me tourne le dos et s'éloigne. Une figure inconnue, énigmatique. Elle s'en va vaquer à des occupations qui très certainement n'existent plus de mon temps. Plongée dans l'ombre de la chaumière, je la discerne malgré tout avec son haut rose et sa longue jupe d'automne. Pourtant, ce n'est pas l'automne. Les arbres et leurs feuilles le démentent. Quelqu'un ou quelque chose ici donc ment.
La chaumière possède une allure pittoresque pour un esprit trop moderne. Mais elle est belle cette chaumière, basse, les moellons clairs et tendres, complétés d'une fenêtre verte, à défaut de bois vert. La toiture descend en pente raide, faite de paille et d'une épaisseur respectable. La cheminée semble fumer des nuages blancs et cotonneux. Une illusion. Non des moindres. Non la première. Non la dernière.
L'inconnue a disparu. Je me retrouve seul sur les chemins de ce village. Le soleil radieux me réchauffe la peau. Je rajuste ma casquette pour ne pas être ébloui. J'inspire profondément l'air. J'espère ainsi capter des particules de ciel bleu. De beau temps. De paix et d'un humble repos.
12 novembre 2025
001. Chaumières
L'exercice m'intimide. Assis sur le rebord de mon lit, les draps défaits et empreints d'une lourde odeur de nuit, je fixe le tableau accroché à mi-hauteur au fond du couloir. Des couleurs l'envahissent. Des formes se dessinent. Des traits s'accentuent. Les ombres et la lumière prennent vie. Je pourrais détourner le regard. Mais je ne peux pas. Je ne veux pas. Pas cette fois-ci. Pas cette fois-là. D'un soupir, je me lève. J'enfile ma veste, me couronne d'une casquette et ajuste mes lunettes. D'un geste sec, je noue mes chaussures. Leur cuir fatigué me tire un petit sourire, le souvenir de mes errances passées.
Fin prêt, je m'avance dans le long couloir et me poste devant le tableau. La peinture a séché. L'image qu'il me renvoie n'attend qu'une seule chose, alors j'y plonge.
Le frémissement de l'air me chatouille. Mes poils se dressent. Je frissonne. Toujours. Toujours lorsque je pénètre la toile.
J'ouvre les yeux, lentement, prudemment. Un soleil radieux illumine les cieux. Un autre silence a remplacé celui de mon appartement. Un silence des campagnes où la Petite Nature s'occupe de remplir les espaces. L'air est pur. L'air est frais. Devant moi, les cheminées fument et leurs volutes ondulent. Les maisons se serrent les unes contre les autres en troupeau. Les toits alternent les couleurs, tantôt ardoise, tantôt tuile, mais je voudrais y voir du rose. L'envie me prend te tirer une bouffée de tabac, de fumer à la manière de ces cheminées. J'ignore pourquoi.
La Nature cerne les habitations à l'horizontale. En haut et en bas, des champs ou des prairies règnent. Des arbres, quelques-uns, s'éparpillent à peine; avec peine; à la traîne. Tout en haut, au sommet de la toile, un morceau de ciel bleu s'invite. Son bleu se gorge de noir à l'extrémité gauche, une invitation à l'orage, une esquisse de tempête à venir. Au contraire, à droite la lumière s'exprime, une douceur nuageuse, cotonneuse, qui semble oublier d'annoncer la pluie.
Je soupire une nouvelle fois. J'ignore dans quelle aventure je m'engage. Une partie de moi espère que celle-ci durera. Une autre craint que l'abandon s'invite dès demain. Je grimace à cette idée. La vérité, oui, je la connais. Je voudrais un tant soit peu continuer ; voyager parmi les couleurs et les fureurs.
11 novembre 2025